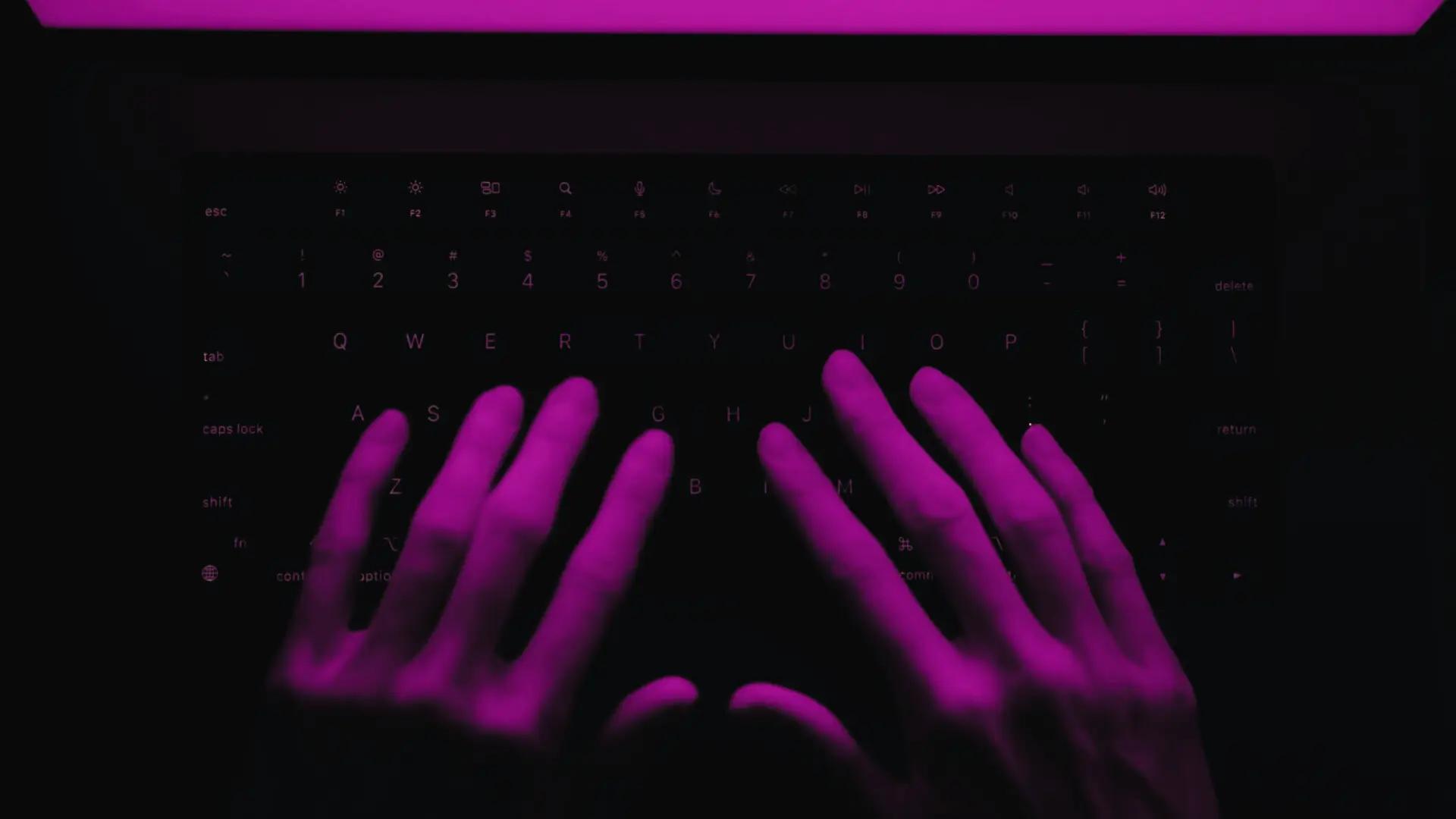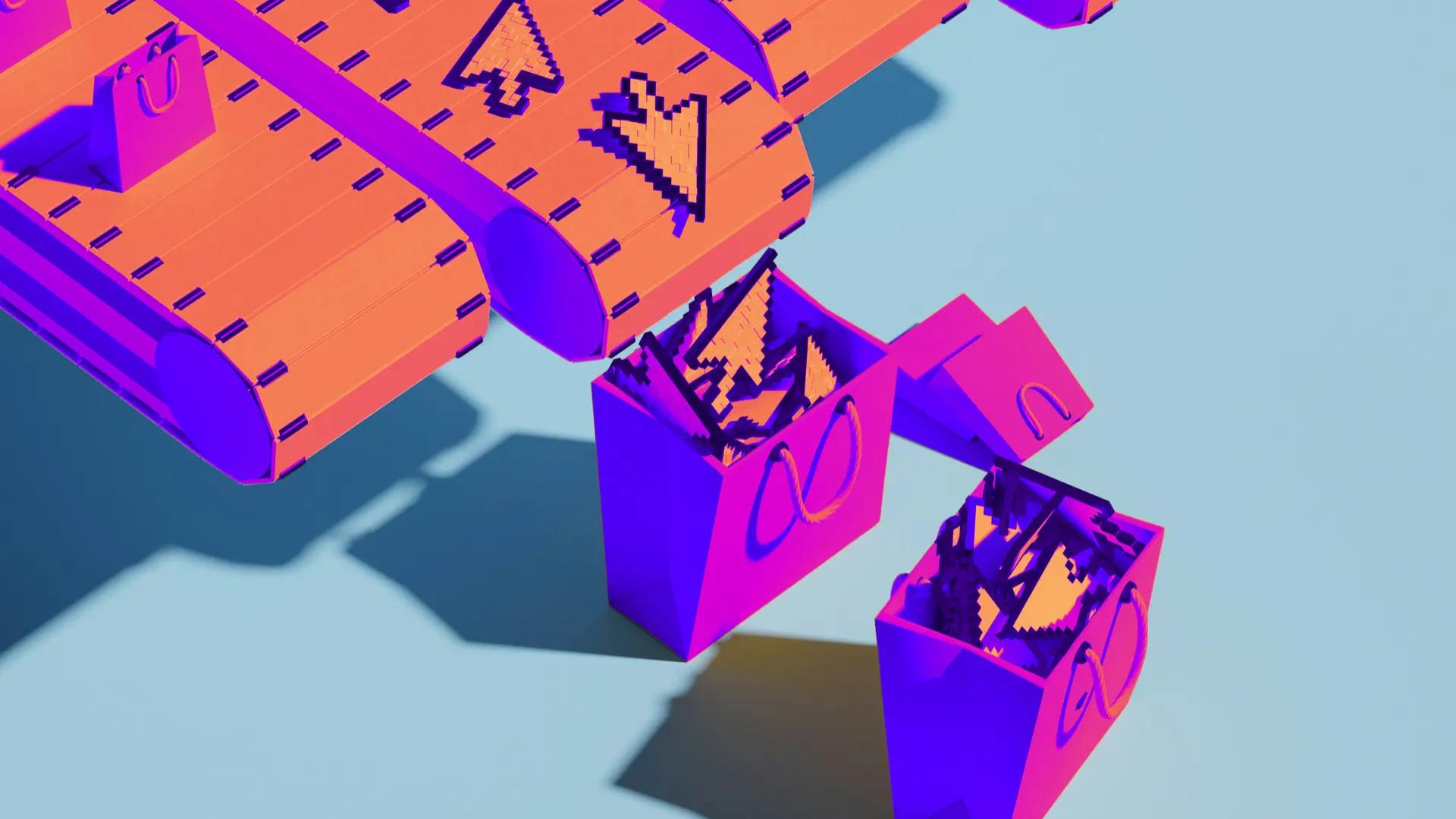Eric Alard : entre adrénaline et algorithmes, le sport à l'ère numérique
L'ancien athlète Eric Alard est un habitué des Jeux Olympiques. Exerçant désormais dans le numérique, il explore les liens de plus en plus étroits entre le sport et la technologie, tant pour les sportifs que les spectateurs·rices.
L'article que vous allez lire a nécessité 2 journées de travail.
Bonjour Eric Alard, pouvez-vous commencer par vous présenter ?

Je suis directeur des relations école-entreprise chez ENI, l'école informatique. Ce service permet aux apprenant·es de trouver des stages ou des alternances.
Avant ça, j'ai eu une longue carrière dans le milieu du sport, dans le bobsleigh plus particulièrement. J'y suis resté pendant 30 ans, à la fois en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur coach d'équipe. Au final, j'ai fait cinq fois les JO, deux fois en tant qu'athlète, trois fois en tant qu'entraîneur. Lors de ma dernière expérience, j'étais head coach de l'équipe suisse, championne olympique en 2014.
D'après votre expérience, à quel point le digital peut-il intervenir dans le quotidien d'un·e athlète ?
De plus en plus d'outils technologiques font partie du quotidien des athlètes de très haut niveau. Ce qui permet d'améliorer les performances, gérer la fatigue, les blessures, etc. Avec cette question : qu'est-ce qu'on embarque avec nous quand on fait de la performance ? Un capteur de puissance sur un vélo, un cardiofréquencemètre quand on va courir, etc. On a tout un tas d'analyses vidéos, d'analyses de temps.
On a aussi de plus en plus d'analyses médicales. On va prendre par exemple la composition du sang avant et après l'effort, pour voir comment il réagit. On sait qu'aujourd'hui, sur les sports d'endurance, certain·es athlètes s'entraînent en altitude pour générer des globules rouges. Et puis, quand ils reviennent à l'altitude de Paris, ils·elles auront plus de globules rouges que s'ils·elles étaient restés en ville. Donc ils·elles iront plus vite, plus longtemps.
Dans les équipes professionnelles, aujourd'hui, on recrute des postes en lien avec ces technologies. C'est-à-dire qu'à une époque, on avait un·e entraîneur·se. Après, on a eu un·e entraîneur·se plus un·e préparateur·rice physique. Après, on a rajouté des diététicien·nes, des préparateurs·rices mentaux.
Aujourd'hui, on a des data scientists qui sont chargé·es de faire en sorte que toutes ces données soient exploitables, en un minimum de temps possible, pour les entraîneurs·ses, pour celles·eux qui prennent les décisions.
Eric Alard
Parce que c'est bien beau de récupérer de la data, mais il faut en faire quelque chose derrière. Si on la collecte juste pour la collecter, ça ne sert à rien. Par exemple, maintenant, on a des outils comme les drones qui permettent d'observer des situations tactiques sur des sports collectifs d'extérieur (rugby, football...). Mais si derrière, il faut un mois de traitement pour obtenir une info, ça peut être trop tard.
Donc il y a aujourd'hui toute une armada de ressources humaines autour des data permettant d'améliorer, d'individualiser l'entraînement des sportifs·ves de très haut niveau.
Tout ça fait qu'on a de plus en plus de données : il faut savoir faire le tri. Et puis il y a aussi un moment où il faut faire confiance, parce que ça reste une question d'hommes et de femmes sur la ligne de départ, qui essayent d'être plus forts que les autres à côté. Parfois, dans certains sports, le matériel fait la différence. Mais on a beau avoir le meilleur matériel, si le jour J on craque, quelqu'un avec un moins bon matériel pourra nous battre.
Et du côté des sportifs·ves amateurs·rices ?

C'est un phénomène qu'on constate aussi. Aujourd'hui, la plupart de celles·eux qui aiment courir possèdent une montre connectée, consultent leurs pulsations ou un GPS. Et puis quand on revient, on aime bien montrer sur les réseaux sociaux la distance ou le parcours qu'on a fait.
De nos jours quand on part faire du sport, on a nos écouteurs avec Spotify, on a notre smartphone, notre montre connectée. Et puis on se dit : "Tiens, j'ai fait une minute de moins que la dernière fois !". On va regarder un GPS qui nous guide, il n'y a même plus besoin de réfléchir à l'avance au parcours. Tout ça, ce sont des choses qui parfois permettent à des gens de se mettre au sport. Alors qu'ils n'en avaient pas envie parce qu'ils se disaient "Je n'ai pas envie de regarder une carte.", "Et si je me perds ?"...
Aujourd'hui, on ne se perd plus. Du coup, ça c'est aussi un bon aspect de la technologie : permettre à des personnes de découvrir le sport. On l'a vu pendant le Covid avec un bon nombre d'applications qui ont fleuri pour faire du sport chez soi. Beaucoup de personnes s'y sont mises parce qu'elles ont compris qu'elles avaient juste besoin d'une chaise ou d'un tabouret pour faire du sport. Et ce message-là, sans technologie, il passait moins bien.
Tout cet aspect data, capteurs, mesures... est-ce que ça peut mener à des dérives ?
Oui, il peut y avoir des dérives. Se fier non plus à ses sensations, mais à ce que dit la technique. Devenir obnubilé·e par ça. Par exemple si quelqu'un vous dit : "Tu dois dormir 7 heures par nuit pour récupérer", mais la nuit d'après vous dormez 6h30. Et le lendemain, pour une raison X ou Y, vous êtes moins performant·e à l'entraînement. L'explication va être : "C'est parce qu'il me manque une demi-heure de sommeil"...
Ça peut même parfois briser du potentiel ! Un athlète qui se dit : "Tiens, mes tests me montrent que je peux faire ça, je me sens bien mais je suis au niveau qu'on me dit. J'aurais envie d'aller plus loin, mais parce que le capteur me dit non, c'est ton maximum, je n'essaye pas de dépasser ma limite en fait." Alors que dans certains contextes, on pourrait se dire qu'on dépasse la limite.

Un bon exemple, c'est dans le cyclisme. Aujourd'hui les cyclistes sont à la pointe sur tous ces capteurs : puissance, watts, ils savent exactement combien de minutes ils peuvent tenir, à la seconde près.
L'année dernière au Tour de France, dans un contre-la-montre, Jonas Vingegaard était en train de rouler et voyait les watts qui s'affichaient sur son capteur. Et il s'est dit : "Mon capteur doit être cassé, parce que je me sens super bien alors que je dépasse les watts que j'aurais dû prévoir." Peut-être qu'à un moment, il aurait pu se dire : "Je vais ralentir, parce que sinon je vais être trop fatigué.", mais ce jour-là, il était peut-être dans une forme exceptionnelle, et il a dépassé tout ce que la technologie et la science auraient pu lui dire (son capteur n'était pas cassé du tout).
La technologie, ça peut aider. Mais à un moment, il faut aussi faire appel aux sensations, à cette espèce d'adrénaline, de stress qui vient lors des grandes compétitions comme les JO. On s'est préparé·e de manière scientifique, et puis le jour J on donne le maximum.
Eric Alard
Qu'est-ce que l'apparition et la généralisation des réseaux sociaux, au fil de ces 15 dernières années, ont changé pour les athlètes ?
Beaucoup de choses ! La première, c'est que certain·es athlètes deviennent des influenceurs·ses, quelque part, en partageant leur expérience. Donc, ils touchent une communauté plus grande.
Quand j'ai commencé le sport à la fin des années 80, pour être connu·e, il fallait passer à la télé : c'était un canal très restreint. Aujourd'hui, vous avez des sportifs·ves qui, grâce à des réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, peuvent toucher une grosse communauté. Et si jamais la manière dont ils·elles communiquent plaît, les fans augmentent. Ce qui peut amener plus de sponsors, de moyens pour s'entraîner, etc. C'est un cercle vertueux... mais ça peut aussi amener plus de pression le jour J.
Si on n'a que notre famille qui nous regarde performer, ce n'est pas la même chose que 100 000 followers qui sont prêt·es à nous encourager... mais aussi à nous dire sur les réseaux : "Tu es nul·le".
Eric Alard
De quoi amener une pression supplémentaire qui va peut-être pousser l'athlète à explorer un côté préparation mentale auquel il·elle n'avait pas pensé. Non pas pour sa performance technique ou physique le jour J : il·elle la maîtrise et se sent en confiance là-dessus. Mais peut-être pour gérer ses haters, ces internautes qui vont lui dire : "Tu es moche quand tu cours", "Ton saut était pourri", "Tu nous dis que tu vas gagner pendant des mois, mais tu arrives quatrième, pourquoi on t'a suivi·e ?", etc.
D'un côté, ça apporte de la notoriété, mais de l'autre côté, on peut se sentir stressé·e si on n'est pas formé·e. Maintenant, il y a beaucoup de formations pour les sportifs·ves de haut niveau qui intègrent ces sujets. Comment gérer les réseaux médiatiques, les réseaux sociaux... du média training, en fait.
Il y a un côté positif aux réseaux sociaux, mais comme chaque pièce a deux faces, il y a aussi le côté négatif qui peut le jour J vous oppresser, vous stresser, et faire en sorte que vous n'arrivez pas à réaliser une performance.
J'ai pu voir cette évolution parce que mes premiers jeux, c'était en 92 à Albertville : Internet existait tout juste. Les derniers, c'était en 2014 à Sotchi : là, on était en plein boom des réseaux sociaux, même si Instagram n'avait pas le potentiel d'aujourd'hui et TikTok n'existait pas encore.
Et pendant ces JO, il y a un moment où je me suis dit : "il faut que j'arrête de regarder mon téléphone portable". Parce qu'on a des sollicitations qui viennent de partout ! Et même de gens qu'on ne connaît pas mais qui savent qu'on est à Sotchi, et qui nous disent : "C'est comment là-bas ? Le village, il est beau ? Est-ce qu'on mange bien ?". Et finalement, on n'est plus concentré sur la compétition. Parce que l'interaction, elle est tout de suite.
En fait ça rajoute une vraie charge mentale pour les athlètes. Il faut penser à recharger son téléphone, se dire : "Est-ce que là, je poste une photo ? Est-ce que c'est bien pour ma concentration ? Que va dire mon entraîneur·se s'il·elle voit qu'à 20 minutes de mon départ, j'ai posté une photo sur les réseaux sociaux ?". Mais d'un autre côté, nous, spectateurs·rices, on demande ça.
Justement, la technologie a-t-elle eu un impact pour les spectateurs·rices ?
La technologie a changé notre regard sur le sport. Je me souviens de la première expérience vraiment immersive pour vivre l'intérieur d'une compétition. C'était Les Yeux dans les Bleus, à l'époque de la Coupe du monde 98 de football, ce reportage qui nous a fait découvrir l'équipe de France.
Aujourd'hui, c'est commun ! Et nous, on en redemande. On va voir un match en live dans un stade ou une salle de sport, et à la mi-temps qu'est-ce qu'on fait ? On sort son smartphone et on regarde les résultats des autres, on regarde des ralentis, on veut avoir des infos de dernière minute. A la mi-temps, on peut même voir des fois les vestiaires.
Les joueurs·ses, sur le terrain, se cachent la bouche parce qu'il y a des spectateurs·rices (spécialistes de ça) qui lisent sur les lèvres, pour après publier sur les réseaux : "Tiens, il a dit ça sur telle et telle personne".
Eric Alard
Je vais vous donner un exemple au bobsleigh. Quand j'ai commencé, on avait l'interdiction d'avoir des appareils électroniques à bord qui puissent prendre des mesures. C'était interdit par le règlement. Puis à un moment, pour que ce soit plus attractif et que les spectateurs·rices comprennent un peu mieux le bobsleigh, il est devenu obligatoire d'avoir un capteur sur nos bobs. On est passé d'interdit à obligatoire, pour mesurer la vitesse instantanée, l'angulation dans les virages... tout un tas de données peu utiles pour les athlètes, mais dont on se sert pour les spectateurs·rices.
Donc ça aussi, ça change les demandes côté spectateur·rices et forcément, l'organisation en veut de plus en plus. On l'a vu avec des séries sur Netflix, où l'on voit les coulisses de la Formule 1, sur le Tour de France également. Tout ça, il faut en prendre conscience : les athlètes se retrouvent avec des caméras qui les suivent, alors qu'avant ils·elles étaient tout·es seul·es, peinard·es.

Une question plus personnelle : qu'est-ce qui vous a fait passer du sport à la Tech ?
J'ai vécu mon adolescence avec la tech : dans les années 80, j'ai eu des ordinateurs qui étaient mille fois moins puissants que nos smartphones de base aujourd'hui. J'ai toujours aimé la tech et j'en ai fait très vite un outil pour performer en sport. J'utilisais un ordinateur portable à l'époque où il n'y avait presque pas de disque dur, et j'ai programmé des bases de données en dBase III pour essayer de calculer quelle était ma meilleure paire de patins suivant la température extérieure, faire tout un tas de schémas...
J'ai toujours eu cette envie-là, j'ai fait plein de statistiques quand j'étais entraîneur sur le bobsleigh pour voir quelles étaient les meilleures trajectoires. J'ai beaucoup travaillé là-dedans et ça me plaisait, c'était une passion. Donc assez vite, une fois ma carrière finie, j'ai passé un DUT informatique.
Je n'ai pas toujours eu les moyens de mettre en pratique ce que j'avais en tête parce que le bobsleigh, ce n'est pas un sport où on a beaucoup de moyens. Les moyens qu'on a, on les utilise pour acheter du matériel performant, des bobs ou des patins, mais pas forcément dans le côté annexe. Moi, j'ai réussi à faire ma place dans le bobsleigh parce que cette compétence, je l'avais en moi : alors je faisais des tableaux Excel assez complexes pour faire des probabilités, des indices de performance, etc. Et ça donnait un avantage aux équipes que j'entraînais.
Pendant longtemps, j'ai fait ces analyses graphiques avec Excel et puis je les imprimais. Tandis que des collègues entraîneurs utilisaient des calques avec des papiers millimétrés à la règle, parce qu'ils n'avaient pas cette compétence-là. Quand je suis arrivé entraîneur en 98-99, j'avais 30 ans : je me retrouvais face à des entraîneurs de 60 ans en fin de carrière, qui n'avaient jamais connu l'informatique. Alors oui, ça marchait des deux côtés, c'était deux manières différentes de faire les choses... sauf que ça leur prenait une heure et moi je mettais 10 minutes. Donc il m'en restait 50 pour faire tout un tas d'autres choses.
Quel est votre regard sur l'intelligence artificielle ?
L'intelligence artificielle, dans mon métier ou dans le sport, je la vois comme quelque chose qui permet d'aller plus vite sur des choses basiques.
Eric Alard
Vous tapez quelque chose dans ChatGPT, Mistral, Dust... peu importe ce que vous utilisez. Mais les choses basiques, vous n'avez plus de temps à perdre pour ça. Du coup, ça vous laisse du temps pour aller sur des choses qui correspondent à ce que vous savez faire vous.
Et c'est là où on va faire la différence. Parce que si on tape tous la même quelque chose et qu'en trois minutes, ChatGPT nous donne la réponse, c'est après qu'on voit vraiment la qualité des personnes qui apportent quelque chose en plus. ChatGPT me fait 70% du travail : maintenant, la différence va se faire sur les 30 derniers pourcents. C'est là où il faut qu'on soit capables d'apporter nos compétences, nos connaissances et de faire la différence.
Sport et Tech : le mot de la fin ?
Les technologies, le numérique, ça change les athlètes et ça change la manière dont on consomme le sport. Mais en fait, il faut bien se dire que le sport a toujours été un reflet de la société.
Aujourd'hui, la société est technologique... donc le sport devient technologique.
Eric Alard
Il s'adapte, il vit avec son temps. Et comme maintenant on met de la technologie partout, le sport en met partout aussi.
[Photo de couverture : Onur Binay]
Soutenez-nous en partageant l'article :