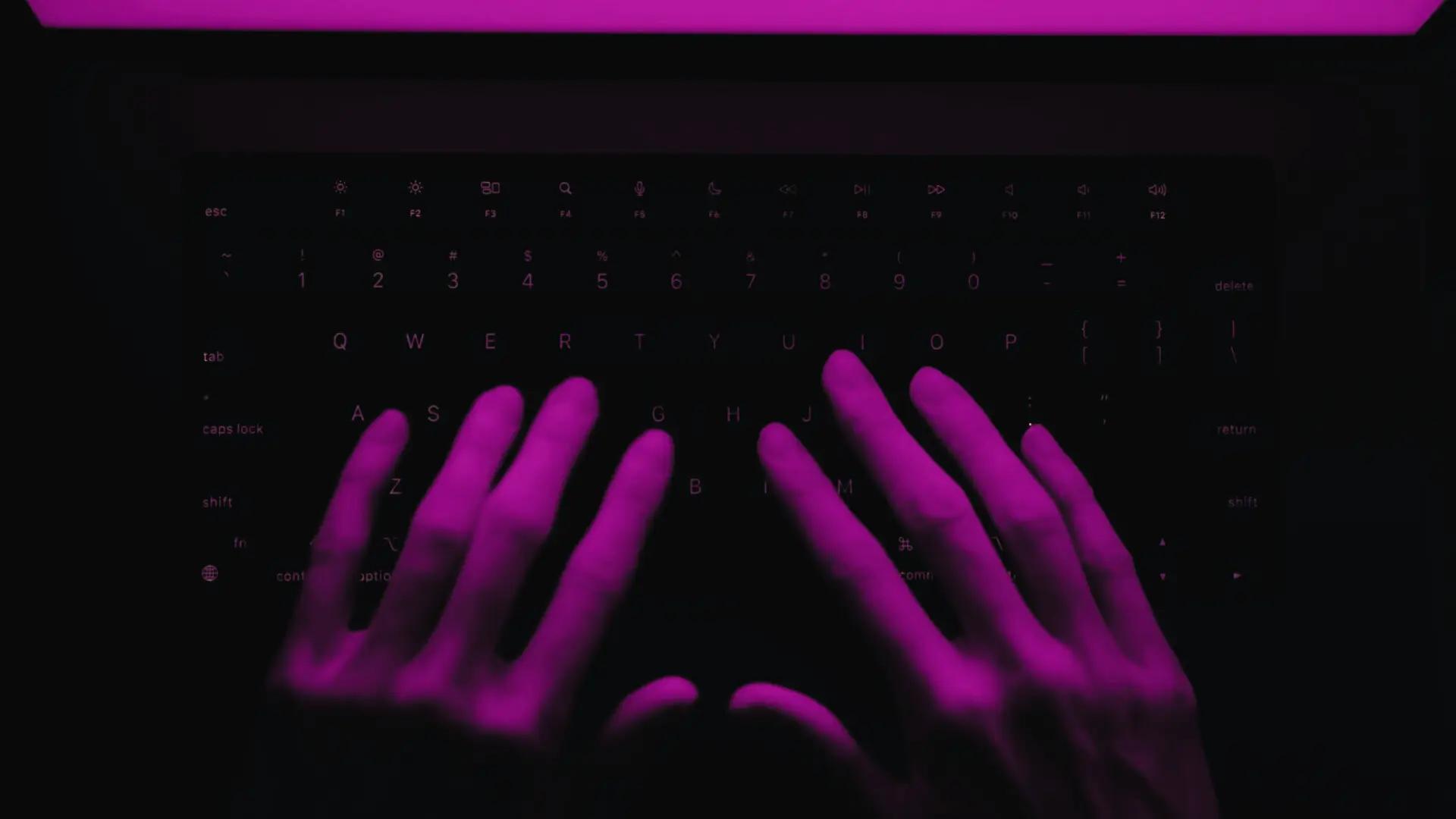Infobésité : comment protéger sa santé mentale dans un monde hyperconnecté
Sur le Web, l’information est partout. A l'usure, un véritable épuisement peut être ressenti face à cette exposition constante, dans un cadre personnel comme professionnel. Dans ce contexte, savoir repérer les risques et mettre en place certaines habitudes peuvent contribuer à préserver une bonne santé mentale.
L'article que vous allez lire a nécessité 2 journées de travail.
L’infobésité : qu’est-ce que c’est ?
Le terme « infobésité » est un mot-valise qui associe « information » et « obésité ». On l'utilise lorsque le volume d’informations reçu par un individu dépasse sa capacité à traiter ces informations. Deux niveaux principaux sont concernés :
- Cognitif, avec une affectation des capacités de concentration et de mémorisation.
- Emotionnel, avec une surcharge mentale.
Si l’infobésité a été théorisée au début des années 1960 par l’économiste Bertram Myron Gross, le néologisme lui-même est apparu en 1993. Le journaliste américain David Schenk, auteur de l’ouvrage Data Smog (Harper Collins, 1997) parlait quant à lui d’overload (qui signifie « surcharge » en français) pour désigner une surcharge informationnelle documentée.
53%
des Français·es disent souffrir de fatigue informationnelle. 38% déclarent en souffrir « beaucoup ».
Source : "Les Français et la fatigue informationnelle : Mutations & tensions dans notre rapport à l’information" - ObSoCo, Arte & Fondation Jean Jaurès
L'expression désigne donc une surcharge informationnelle qui peut aller jusqu’à la pathologie. À partir du moment où l’individu en souffre, physiquement comme psychiquement, on peut parler de maladie : syndrome de saturation cognitive, stress et fatigue pouvant aller jusqu'à l’épuisement. Une personne surinformée peut en arriver à souffrir de dépression et de burn-out (syndrome d’épuisement professionnel).
Un trop-plein d’informations
La multiplication des outils d’information et de communication s’accompagne d’une profusion d’informations et de sollicitations. L’individu hyperconnecté, face à la masse d’informations qu’on appelle aussi « bruit » ou « nuage informationnel », peut se trouver tétanisé devant un choix à faire.
Un risque de désinformation ou de mésinformation, lié à la dégradation de la qualité de l’information, existe également. En effet, à partir d’un certain nombre d’informations, il devient difficile de distinguer les bonnes des mauvaises informations (fake news, c’est-à-dire informations erronées).
Quelle que soit la catégorie de population ou d’âge, l’hyperconnexion et la surexposition aux informations ne garantissent pas le fait de pouvoir s’informer sans difficulté, ni sans conséquence. Et c’est tout particulièrement le cas de cette jeunesse hyperconnectée qui, dans cet univers numérique impitoyable de « Super Size News », semble être au contraire celle qui en souffre le plus. Faute de freins, faute d’hygiène informationnelle, faute d’éducation concrète aux médias.
Source : "Les Français et la fatigue informationnelle : Mutations & tensions dans notre rapport à l’information" - ObSoCo, Arte & Fondation Jean Jaurès
En quoi l’infobésité impacte-t-elle la santé mentale ?
L’infobésité impacte psychiquement celles·eux qui évoluent dans une société où les informations abondent et qui prône immédiateté, spontanéité, rapidité, efficacité.
Les médias et réseaux sociaux ne sont pas étrangers à ce phénomène. Systématiquement, les actualités s'y répètent : textes, images, documents audiovisuels apparaissent en boucle, se multiplient sur les supports numériques. Les données y sont alors partagées, commentées, relayées.
Or les publications des médias s’avèrent souvent anxiogènes, parce qu’elles abordent consécutivement des événements gravissimes et des faits divers, qui seront ensuite diffusés sur les réseaux sociaux, relayés massivement par les créateurs·rices de contenu ou influenceurs·ses.
Enfin, dans une société où tout devient urgent, des troubles relationnels apparaissent : notamment à cause d’une sur-utilisation de la messagerie, et de la consultation quasiment continue du smartphone. Le terme phubbing, combinaison de snubbing (« ignorer, snober ») et phone (« téléphone »), désigne ainsi le fait qu’une personne interagisse avec son smartphone au lieu de prêter attention à une autre personne s’adressant à elle. De quoi altérer la qualité des relations interpersonnelles.

Cet article est gratuit
Aidez-nous pour que ça le reste !
L’espace privé affecté
Lorsqu'un individu étouffe sous l’excès d’informations, cela peut notamment bouleverser ses processus de décision. La peur du risque est plus grande et il est très difficile de prioriser ainsi que de hiérarchiser les données reçues. On passe alors plus de temps à s’informer qu’à agir : recherches sur l’actualité, consultation de sites de mode et de décoration, recherche de voyages… qui ne se concrétisent pas forcément.
Par ailleurs lorsque la connexion s’avère permanente, le sommeil en est dégradé. Si sa qualité s’amoindrit, le sommeil est aussi fragmenté et perturbé par la suppression de la mélatonine (hormone du sommeil) causée par la lumière bleue que nos smartphones diffusent.
A l’heure où l’activité intellectuelle et émotionnelle devrait diminuer, les réseaux, internet ou autres mails génèrent une excitation cognitive tout à fait préjudiciable au sommeil. Cette tension nuit au ralentissement nécessaire à l’instauration du sommeil et elle est relayée par “l’effet sentinelle” induit par les téléphones portables laissés allumés la nuit.
Source : INSV (Institut National du Sommeil et de la Vigilance)
Zoom sur l’espace professionnel
L’espace professionnel est particulièrement touché par le phénomène d’infobésité : multiplication des courriels, messagerie, documents, agenda…
L’expression « mille-feuille communicationnel » (telle que l'emploie la chercheuse Suzy Canivenc) renvoie au passage d’une information à une autre, aux échanges réalisés systématiques par courriels, ce qui perturbe et par conséquent minore la qualité du travail en cours.
84%
des salarié·es consultent leurs mails professionnels en dehors des heures de travail.
Source : Les bêtes noires de la communication au travail en 2023 - LiveCareer
En proie au blurring, de nombreux travailleurs·ses restent connecté·es en permanence : la séparation entre vie personnelle et temps professionnel devient floue. La surcharge de travail est banalisée, la gestion du temps n’est plus efficiente, l'attention et la réactivité altérées. Un tel épuisement peut se transformer en burn out (syndrome d’épuisement professionnel). S’ensuivent alors au sein de l’espace professionnel une angoisse permanente et un sentiment de frustration, d’inefficacité et de culpabilité.
144 courriels
gérés en moyenne par les salarié·es français·es chaque semaine
Source : Référentiel annuel (2023) - OICN (Observatoire de l’infobésité et de la Collaboration numérique)
Que dit la loi face à l’infobésité professionnelle ?
Le droit à la déconnexion est entré dans le Code du travail en 2016 (Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels). La législation impose ainsi :
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - Article 55
Il s’agit d’autoriser aux salarié·es à ne plus être disponible pour leur employeur·se en dehors de leurs horaires de travail, et de protéger leur temps de repos. Enfin, la Loi travail / El Khomri du 1er janvier 2017 souligne précisément le droit à la déconnexion.
La gouvernance d’informations : une solution plurielle
Plusieurs solutions peuvent être mises en place, dans l’espace privé comme dans l’espace professionnel :
Dans l’espace privé, une meilleure gestion de l’information passe nécessairement par une éducation, une sensibilisation aux médias. Il s’agit essentiellement, en plus de prendre une certaine distance par rapport aux médias, de mieux employer les vecteurs d’informations. Car scroller (« faire défiler des contenus ») continuellement sur son smartphone se limite souvent à une activité purement passive. Or une meilleure utilisation, voire une déconnexion partielle de l’information, permet une connexion plus intelligente et un rapport plus sain à l’information.
Dans un cadre professionnel, il s’agit également de sensibiliser les salarié·es : savoir absolu et compréhension complète de l’information sont impossibles à atteindre. Puis de déterminer en amont les informations dont ils·elles ont besoin, et prévoir à l’avance ce que ces données apporteront en termes de connaissance du marché. Ainsi anticipées et organisées, les informations collectées s’avèrent plus « digestes ». La matrice Eisenhower, qui permet de prioriser ses tâches en différenciant ce qui est urgent de ce qui est important, peut constituer un outil utile tout au long de cette démarche.
Face à la surcharge informationnelle, quelles solutions concrètes ?
- Abandonner l’idée d’exhaustivité. Comme il est consciemment impossible de tout voir et de tout traiter, il est préconisé de limiter les sources d’information.
- Sélectionner soigneusement les applications et les réseaux sociaux pertinents, déterminer et prioriser ce qui est urgent et adopter un traitement de l’information structuré.
- Prévoir des moments de déconnexion.
- Cesser de valoriser le multi-tasking (« travail en multi-tâches ») au niveau de la culture d’entreprise.
- Penser à la curation : un curateur de contenus réunit les informations importantes pour ne retenir que ce qui est pertinent, les analyse, les associe à d’autres informations et les classe. Quelques exemples : Scoop.it, Netvibes ou encore Feedly (sur lequel vous pourrez ajouter Les Enovateurs).
- Privilégier les échanges de vive voix et réintroduire le dialogue en présentiel.
Ces préconisations peuvent pour la plupart, sinon fonctionner dans leur ensemble, du moins s’adapter au cadre privé comme au cadre professionnel. Il s’agit essentiellement d’une remise en question du sens et du rapport à l’information de manière générale, dans la mesure où le phénomène d’infobésité dépasse désormais une catégorisation au singulier pour devenir un réel problème de santé publique.
Références :
- Le Club de Mediapart - La surinformation, une paralysie contemporaine
- Ministère de l'Economie - Lettre de la Direction des Affaires Juridiques : Explosion des données numériques
- Cairn.info - Infobésité, gros risques et vrais remèdes - Caroline Sauvajol-Rialland
- ObSoCo - Les Français et la fatigue informationnelle : Mutations et tensions dans notre rapport à l’information
- INSV - Sommeil et écrans
- LiveCareer - Les bêtes noires de la communication au travail
- OICN - Référentiel annuel de l'OICN (2023)
- Légifrance - Code du Travail - Article L2242-8
- Légifrance - Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
- Ministère du Travail - Le droit à la déconnexion fait son entrée dans le code du travail
- Welcome to the Jungle - Faut-il protéger vos salariés des (trop nombreuses) sollicitations digitales ?
- Les Echos Solutions - Matrice d’Eisenhower : mieux gérer ses priorités en 4 points
[Photo de couverture : Egor Vikhrev]
Soutenez-nous en partageant l'article :