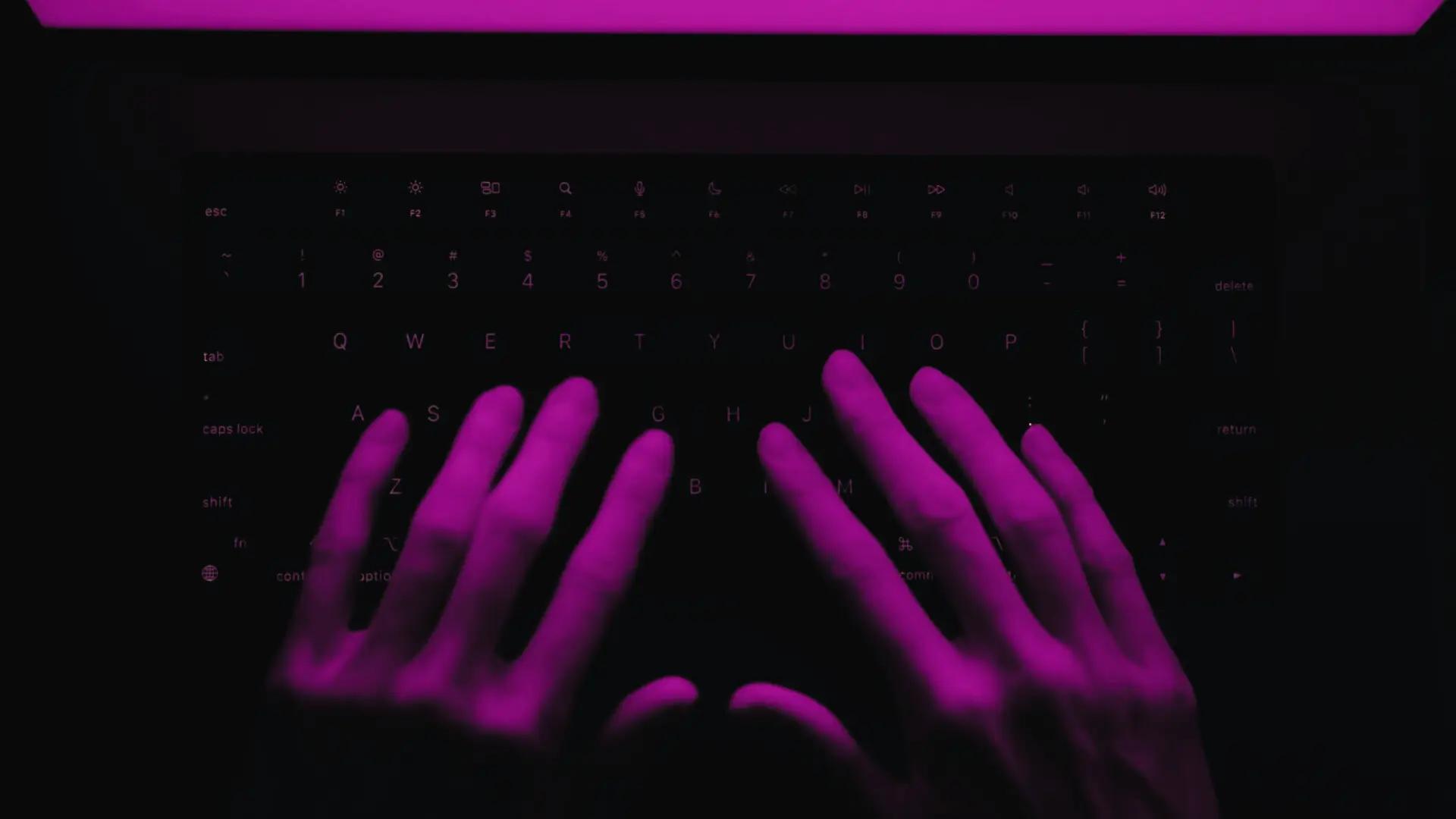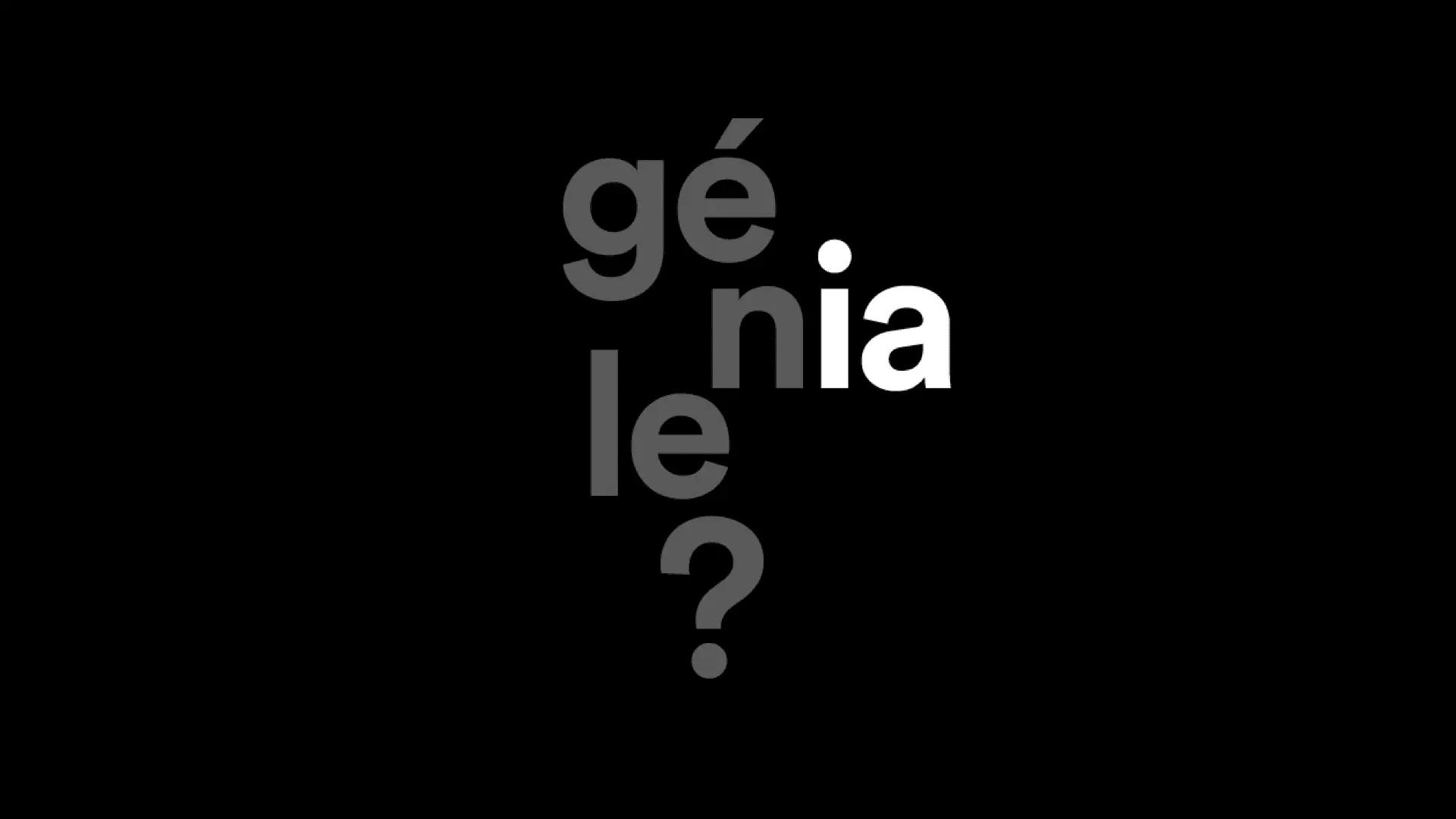Le numérique à la rescousse pour une culture accessible à tous ?
L’accès à la culture pour les personnes en situation de handicap est un problème majeur que les technologies peuvent, en partie, aider à résoudre. Des dispositifs spécifiques peuvent permettre de surmonter certaines déficiences (visuelles, auditives, motrices ou cognitives) qui entravent l'accès aux œuvres d'art, à la littérature ou aux événements culturels.
L'article que vous allez lire a nécessité 2 journées de travail.
75%
des personnes en situation de handicap ont visité au moins une fois par an un lieu culturel, au cours de ces dernières années.
"L'accès à la culture des personnes en situation de handicap" (2022) - Fondation Malakoff Humanis Handicap
Ce chiffre est stable par rapport au sondage de 2017 (72%). Le cinéma est le lieux le plus fréquenté, 88% des répondant·es s'y rendant au moins une fois par an. 83% des répondant·es visitent des musées et des expositions, 79% vont dans des parcs de loisirs, 72% se rendent dans des festivals de musique et 60% au théâtre.
Entre 2017 et 2022, la perception de l'accès à la culture s'est améliorée pour les personnes en situation de handicap : 48% d'entre elles (+9 points) estiment cet accès plus facile. Cependant, les accompagnant·es ne partagent pas cet avis et jugent que l'accès s'est compliqué : 70% le pensent aujourd'hui, contre 64% il y a cinq ans. Les principaux obstacles identifiés par les personnes handicapées sont le prix (40%), l'affluence (27%, montant à 36% pour les festivals de musique en plein air), et l'accessibilité des lieux (19%).

Cet article est gratuit
Aidez-nous pour que ça le reste !
Quand le Ministère de la Culture se penche sur l'accessibilité des établissements
Depuis 2003, à la demande du ministère de la Culture, une quarantaine d'établissements publics collaborent pour améliorer l'accueil des personnes en situation de handicap dans les lieux culturels. La RECA (Réunion des établissements culturels pour l’accessibilité) met en place des actions concrètes favorisant des améliorations variées : architecturales, éditoriales, informatiques et techniques. Chaque année, de nouveaux travaux sont engagés : l'utilisation des nouvelles technologies pour améliorer l'expérience des visiteurs·ses handicapé·es en fait partie.
En parallèle, d'autres structures prennent l'initiative dans le domaine de l'accessibilité, pour mettre à la portée de tous·tes des supports culturels variés.
Faciliter l'accès à la lecture et aux musées pour les personnes mal- et non-voyantes
L’association Valentin Haüy, reconnue d’utilité publique depuis plus de 125 ans, s'engage aux côtés des personnes déficientes visuelles pour leur participation à la vie sociale et professionnelle. Sa mission est « d’aider les personnes aveugles ou malvoyantes à gagner leur autonomie ». Depuis 2009, sa médiathèque permet aux mal- et non-voyant·es d'écouter des livres audio et de découvrir des ouvrages en braille.
L'association propose également une bibliothèque numérique en ligne : Eole. Elle se compose de plus de 70 000 titres à télécharger gratuitement ou à recevoir par voie postale. Ici, le numérique intervient donc pour lever les barrières géographiques. Ils sont destinés aux « personnes pour qui la lecture est difficile du fait de leur handicap : déficience visuelle, handicap moteur, intellectuel, troubles cognitifs, et notamment troubles DYS ».

Une autre initiative, côté musées cette fois : sur son site Internet, dans la rubrique « Ma Cité accessible » et « Je me cultive », La Cité des Sciences et de l'Industrie propose diverses solutions pour accéder aux contenus, selon les différents handicaps des spectateurs·rices. Ces dernier·es peuvent accéder à plusieurs types de ressources numériques suivant leurs besoins.

Par exemple, la Cité des Sciences et de l'Industrie met à disposition des personnes malvoyantes ou aveugles des podcasts, des conférences et des jeux en ligne accessibles avec une synthèse vocale. Ces visiteurs·ses peuvent aussi découvrir l’exposition permanente « Sons » au travers de 9 vidéos sous-titrées. Dans ces dernières, un·e guide accompagne les visiteurs·ses à chaque étape en leur fournissant des explications, les menant dans les salles du musée et les invitant à tendre l’oreille.
Musées et musique pour personnes sourdes et malentendantes
La Cité des Sciences propose également des vidéos sous-titrées et traduites en langue des signes française, permettant aux personnes ayant un handicap auditif de découvrir de nombreux concepts et d’acquérir davantage de connaissances.
Quant au musée d’Arras, il a mis en place en 2019 le dispositif « Musée accessible ». Composé d’un parcours en langue des signes française, il est accessible depuis un smartphone. Huit vidéos présentent chacune un chef-d’œuvre de la collection permanente du musée, afin de les découvrir sous un nouvel angle.
Cette initiative s'inscrit dans une démarche d'inclusion culturelle visant à élargir l'accès à l'art pour tous les publics. L’interprète en langue des signes se tient devant l’œuvre et apporte de nombreuses explications (contexte de la création, origines des noms, histoire, etc.), avant de disparaître quelques instants pour permettre aux spectateurs·rices de contempler l’œuvre.

La Philharmonie de Paris a également choisi de proposer chaque mois de courtes vidéos, dans lesquelles un interprète en langue des signes fait découvrir aux spectateurs·rices les concepts et le vocabulaire de la musique (salle de concert, chœur, vibration, genres musicaux, Opéra, piano, harpe...). Ces vidéos « s’adressent à la fois au public expert en langue des signes française (LSF) et aux débutants, ces vidéos accessibles à tous vous permettront de découvrir la richesse du vocabulaire musical en LSF ».

La culture, plus accessible grâce à la tech ?
Ces technologies permettent aux personnes en situation de handicap d'acquérir une certaine autonomie dans leur accès à la culture, que ce soit par le téléchargement de livres numériques, l'accès à des vidéos sous-titrées, ou des parcours en langue des signes française dans les musées. De plus, la possibilité d'accéder à divers formats (audio, braille, vidéos en LSF, podcasts) permet de répondre aux besoins variés des personnes ayant des handicaps différents (visuels, auditifs, cognitifs).
Cependant, certains publics peuvent encore rencontrer des difficultés d’accès aux technologies (smartphones, ordinateurs, internet), en particulier dans les zones moins connectées. De même pour les personnes rencontrant des difficultés avec le numérique ou atteintes de handicaps cognitifs, peu à l'aise face aux dispositifs nécessitant une certaine familiarité avec des interfaces ou des outils digitaux.
Enfin, l'utilisation de la technologie pour accéder à la culture reste une expérience dématérialisée, par nature moins immersive que la visite réelle d'un musée ou la participation à un concert en direct. L’expérience sensorielle peut être limitée, notamment pour les personnes préférant une interaction physique avec l’environnement culturel.
On peut tout de même considérer que les technologies d'assistance ont considérablement élargi l'accès à la culture pour les personnes handicapées, en leur offrant davantage d’autonomie et d’inclusivité. Malgré les quelques axes d’améliorations subsistants (inégalité d'accès aux outils numériques, complexité de certaines interfaces, expérience culturelle indirecte), les progrès actuels constituent une étape majeure vers une inclusion culturelle plus large, où chacun·e pourra profiter de la richesse du patrimoine et des arts.
Références :
- Art Cena - L’accès à la culture des personnes en situation de handicap
- Universcience - Réunion des établissements culturels pour l'accessibilité
- Ministère de la culture - Cinq ressources en ligne qui rendent la culture accessible aux personnes en situation de handicap
- Eole
- Ville d'Arras - Saint-Vaast et l'ours - Musée Accessible 1/8
- Philharmonie de Paris - Vocabulaire musical en LSF
- La Cité des Sciences et de l'Industrie - Je me cultive
- Ministère de la culture - Handicap : un nouveau regard sur l'accessibilité
[Photo de couverture : Christian Lendl]
Soutenez-nous en partageant l'article :