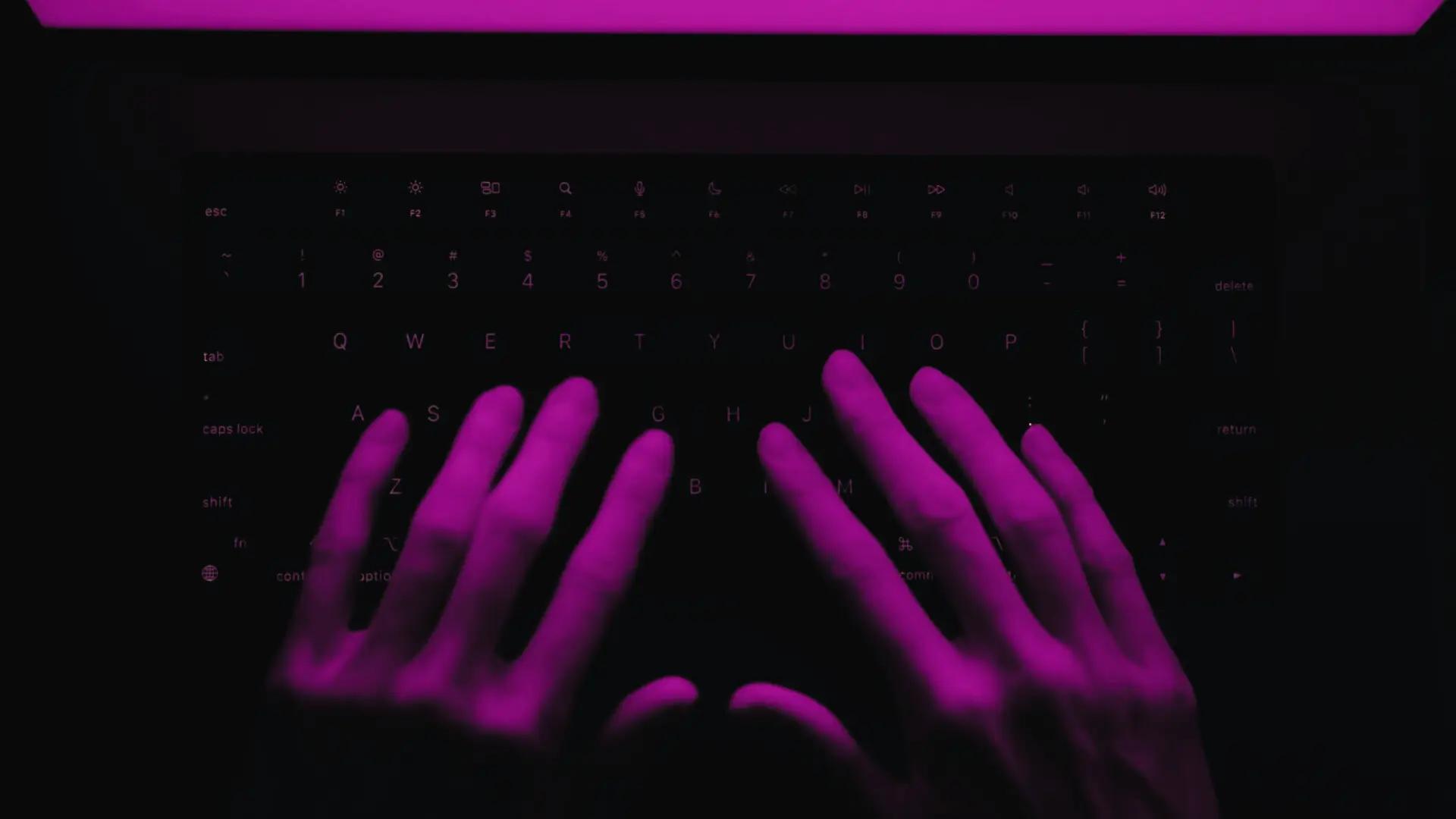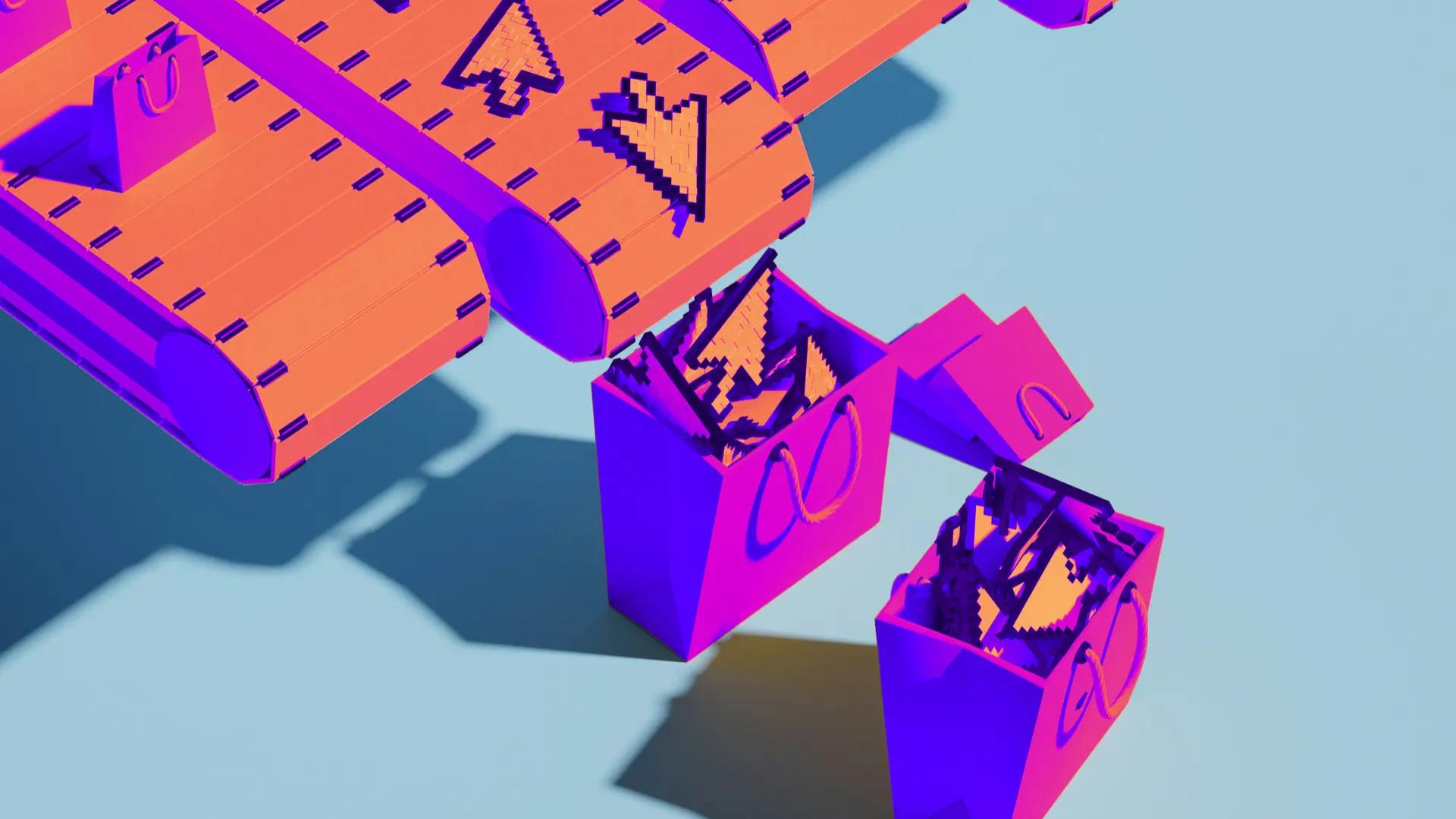Stocker ses données dans le nuage ou les garder près de soi : un dilemme écologique
C'est décidé : il est temps de faire le tri parmi les centaines de documents, photos, vidéos... qui encombrent nos appareils électroniques. En plus de libérer de l'espace de stockage, voilà l'occasion d'opter pour un système de sauvegarde plus responsable. Déplacer de grands volumes de données sur le cloud ou être responsable de son matériel de stockage : chaque solution a ses avantages et ses inconvénients.
L'article que vous allez lire a nécessité 2 journées de travail.
Sauvegarder nos données sur le cloud ou sur nos ordinateurs/smartphones : quelles différences ?
Pour commencer, qu'est-ce qu'un système de stockage local ? Aussi appelé sauvegarde locale, il s'agit d'un lieu numérique où une copie des données est conservée :
- une clé USB
- un disque dur externe
- un NAS (Network Attached Storage): un mini-ordinateur/serveur (sans écran) dédié au stockage d'informations et connecté à la box Internet
- un ordinateur fixe, ou portable
- une tablette
- un smartphone
Autant d'équipements dont nous avons la responsabilité dès l'instant où nous les achetons. Il peut nous arriver de les perdre ou de les endommager (choc, boisson renversée...). La conséquence, dans le pire des cas ? Impossible d'accéder aux contenus sauvegardés dessus. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont pris l'habitude de recourir à diverses solutions de secours (on parle de backup) pour conserver plusieurs copies de leurs fichiers.
A cet égard, avec un trafic internet de plus en plus performant (5G, fibre), le cloud est apparu comme un système de stockage optimal pour entreposer nos précieuses données.
Un signe qui ne trompe pas : depuis le Covid, l'utilisation des plateformes de travail collaboratives a explosé. On peut notamment citer :
- Notion : un outil en ligne permettant de stocker et organiser des notes, documents, images, et même de publier du contenu en ligne accessible à tous·tes.
- Google Drive : célèbre plateforme de stockage et partage des données.
- Canva : un service permettant de créer des visuels (présentations, affiches, publications pour les réseaux sociaux...).
Cette liste est évidemment non exhaustive, et ne représente qu'un aperçu de la réalité. Les outils qui y figurent favorisent un travail fluide, suivi, instantané et en commun. Une évolution significative, puisqu'il n'y a pas si longtemps le travail collaboratif exigeait de télécharger une pièce jointe (par ex. un document Word), puis de la modifier avec un logiciel de traitement de texte avant de la renvoyer.
Avec les différents services Cloud à notre disposition, nos ordinateurs (aussi puissants qu'il soient) sont moins exploités : les opérations complexes sont réalisées sur des serveurs utilisés par ces services Web.
Pour autant, les serveurs ne font pas disparaître le matériel de stockage. Nos données effectuent désormais des aller-retours entre les serveurs des hébergeurs de données, pour que nous puissions y avoir accès à tout moment et aux quatre coins du monde.
La sauvegarde locale est-elle moins polluante que le cloud ?
Lorsque vous entreposez vos données sur un serveur, celles-ci sont envoyées sur les disques durs hébergés dans des centres de données. Ce n'est plus vous qui possédez un serveur, c'est un ensemble de prestataires qui s'en occupent. Ceci comprend :
- l'installation du matériel
- la maintenance des équipements
- la sauvegarde / le remplacement des disques durs jugés trop usés, ainsi que leur nettoyage / recyclage
L'utilisateur·rice peut bénéficier sur le cloud d'un espace illimité (en apparence). Résultat : il·elle risque d'avoir tendance à stocker inutilement des données. Or comme le besoin global en termes de stockage de données ne cesse d'augmenter, cela encourage les hébergeurs à multiplier leurs sites physiques et les concepteurs de disques durs à augmenter leurs capacités. C'est ainsi que l'effet rebond se manifeste.
Bien que des efforts soient réalisés pour construire des centres de données utilisant des énergies renouvelables, les datacenters consomment beaucoup d'électricité. Par exemple, alimenter un site de 10 000 m² revient à fournir de l'électricité pour une ville de 50 000 habitants. Pour protéger les sauvegardes, il faut refroidir les machines en continu avec des systèmes de climatisation et de traitement d'eau. Même si aujourd'hui, l'installation des hébergeurs se trouve de plus en plus à proximité des utilisateurs·rices, les données continuent à utiliser une quantité importante d'électricité pour se déplacer.
Compte tenu de ces éléments, faut-il privilégier la sauvegarde locale ? Une question notamment soulevée lors de l'incendie d'un datacenter OVH à Strasbourg, le 10 mars 2021. L'entreprise a depuis lors été déclarée responsable des pertes de données.
Dans la mesure où vous avez pleinement le contrôle de vos données, la sauvegarde locale peut apparaître comme une bonne alternative. Mais cela implique aussi d'investir dans du matériel (à la fabrication toutefois moins polluante qu'un datacenter). Pour des raisons de transport et de sécurité du matériel, le disque SSD (Solid State drive) apparaît comme une solution de sauvegarde locale plus sûre qu'un disque dur HDD (Hard Disc Drive).
Le SDD est un disque dur utilisant une mémoire flash, un système similaire à celui implanté dans nos smartphones. Par son apparence plus compactée et une utilisation de matériaux plus réduite qu'un disque dur classique, il apparaît comme un outil plus écologique. Pourtant son empreinte carbone est supérieur à celle d'un disque dur. Cela s'explique par le matériel utilisé pour la fabrication des puces, qui nécessite d'utiliser une quantité de chaleur plus importante pour le fonctionnement des installations. Les SDD sont donc très gourmands en matière de consommation d'énergie tout au long de leur cycle de vie.
Nettoyer son serveur et son cloud : un réflexe efficace pour limiter ses coûts environnementaux
Pour un usage personnel, il est plutôt conseillé d'utiliser des disques durs en local plus petits en termes de sauvegarde, et d'effectuer régulièrement un tri dans vos fichiers. Si pour des raisons collaboratives (partage de liens, de documents...) vous devez utiliser le cloud, il est important de nettoyer souvent les fichiers qui ne sont plus utilisés - et éventuellement d'instaurer une date limite de partage quand c'est nécessaire pour enfin archiver les dossiers en interne.
La date limite ou délai de validité consiste à déterminer une date d'expiration au terme de laquelle votre fichier ne sera plus partagé. Une option accessible depuis les paramètres de partage de Dropbox ou Onedrive. Il s'agit d'une solution intéressante pour certains usages : par exemple, pour des monteurs de vidéo qui se partagent des téraoctets de données à cause de la résolution des vidéos traitées.
Pour aller plus loin, certains spécialistes des sauvegardes s'ingénient à distribuer les données plus ou moins pertinentes en fonction des disques durs et des SSD associés. Le but : mieux répartir les données entre les différents supports physiques, et les préserver de l'usure.
En parallèle, des chercheurs·ses chinois·es travaillent actuellement sur un disque dur permettant de stocker jusqu'à 220 000 DVD. Cela pourrait alors limiter la construction de centres de données... mais reste encore à savoir quel sera l'empreinte carbone de ce nouvel équipement.
Références :
- Le Mag IT: Sauvegarde en cloud ou sauvegarde locale : comment les comparer ?
- ZDnet - SSD ou disque dur : quel stockage pour quel usage ?
- ZDnet - Migration vers le cloud ! Mais à quel point est-ce écologique, en fait ?
- 01net : Stockage cloud ou disque dur externe : que choisir ?
- Siècle digital : Quel impact environnemental pour le Cloud ?
- Nature : A 3D nanoscale optical disk memory with petabit capacity
- ACM Digital Library : The Dirty Secret of SSDs: Embodied Carbon
- Clubic - Pourquoi OVH est condamnée à verser 100 000 euros à un client dont le serveur a brûlé lors de l’incendie de Strasbourg ?
[Photo de couverture : Behnam Norouzi]
Soutenez-nous en partageant l'article :