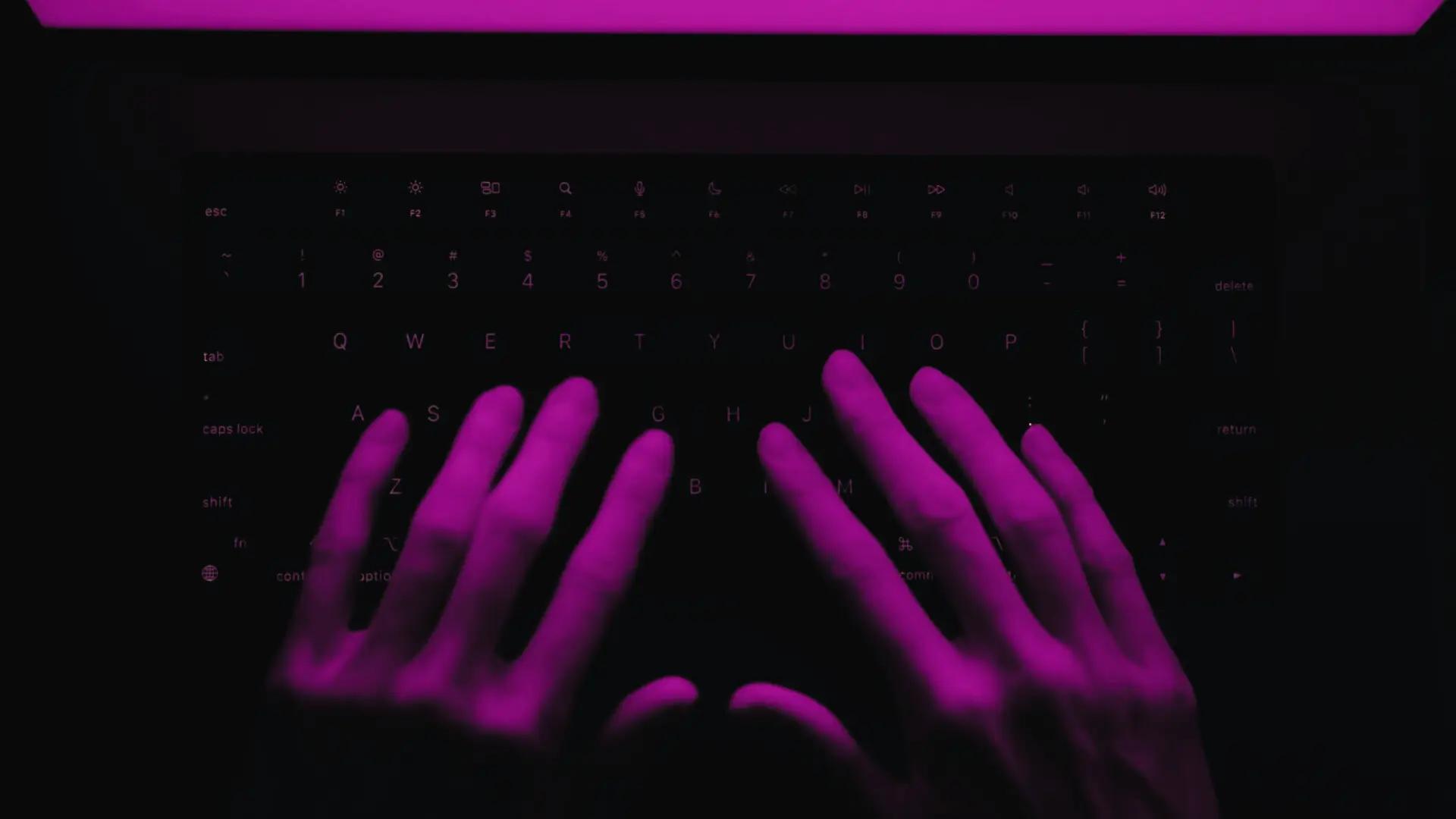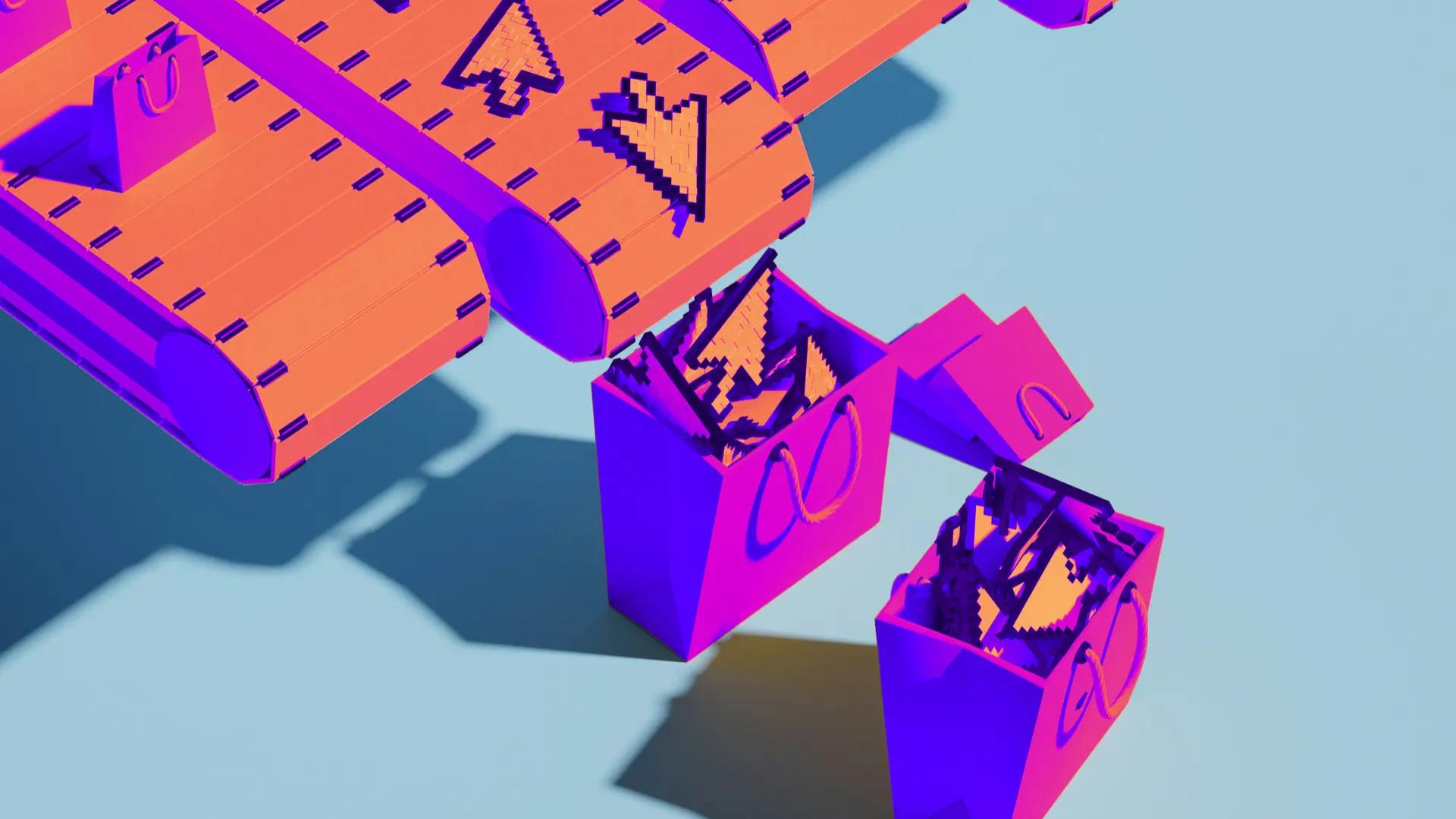Loi REEN et numérique responsable : quelles nouvelles obligations pour les collectivités en 2025 ?
2025 : les collectivités sont désormais tenues de proposer et mettre en œuvre une stratégie numérique responsable. Une nouvelle étape, permettant de repenser le rapport des services publics aux usages numériques omniprésents. Concrètement, voici pourquoi la loi REEN apportera de nombreux bénéfices aux communes concernées ainsi qu'à leurs habitant·es.
L'article que vous allez lire a nécessité 2 journées de travail.
Depuis le 1er janvier 2025, les communes et intercommunalités de plus de 50 000 habitant·es doivent pouvoir présenter une véritable stratégie en matière de numérique responsable. C'est la loi REEN (Réduction de l’Empreinte Environnementale du Numérique), promulguée en France en novembre 2021, qui le stipule dans son article 35 :
Les communes de plus de 50 000 habitants définissent, au plus tard le 1er janvier 2025, une stratégie numérique responsable qui indique notamment les objectifs de réduction de l'empreinte environnementale du numérique et les mesures mises en place pour les atteindre.
LOI n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France
Au-delà d'une nouvelle contrainte administrative, cette démarche aura un véritable impact dans les années à venir.
Article 35 de la loi REEN : concrètement, qu'est-ce qui est demandé aux collectivités ?
Il s'agit de réduire l'empreinte environnementale du numérique sur les territoires concernés. Pour cela, chaque commune et intercommunalité doit définir des objectifs (précis, définis dans le temps et mesurables) à atteindre ainsi que des indicateurs pour mesurer ses progrès dans les domaines suivants :
La commande publique locale et durable, le réemploi, la réparation et la lutte contre l’obsolescence
Pourquoi est-ce important ?
79 % de l’empreinte carbone du numérique provient de nos équipements [...] et ce n’est pas leur utilisation (et donc leur consommation d’électricité) qui est principalement responsable de leur empreinte carbone… mais leur fabrication, à hauteur de 80 % !
ADEME (Agence de la Transition écologique) et Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques)
- Il est donc essentiel de faire durer le plus longtemps possible, et par tous les moyens possibles, les appareils électroniques.
Quelques exemples :
- Privilégier l'achat d'appareils électroniques reconditionnés auprès de structures locales.
- Inclure des clauses de réparation ou maintenance au-delà de la garantie constructeur, ainsi que des mises à jour de sécurité pendant au moins 5 ans.
La gestion durable et de proximité du matériel informatique
Pourquoi est-ce important ?
- Prendre soin des appareils électroniques permet de prolonger leur durée de vie.
- Proposer aux citoyen·nes, entreprises et organismes publics des réseaux locaux de réparation ou d'achat reconditionné offre plusieurs avantages : développement de l'emploi, diminution des émissions liées aux transports...
Quelques exemples :
- Prévoir une fin de vie adaptée pour les équipements électroniques : en les revendant, en les donnant à des associations œuvrant sur le territoire ou en organisant leur collecte par des organismes agréés.
- Apporter une aide concrète (prêt d'un local, subvention...) aux organismes proposant la réparation des appareils électroniques, comme les fab labs ou les repair cafés.
L'éco-conception des services numériques
Pourquoi est-ce important ?
- Un logiciel éco-conçu est plus léger : il consomme donc moins de ressources.
- Un service numérique éco-conçu est accessible à un plus large public, puisqu'on peut y accéder sans problème, même sans posséder un appareil dernier-cri.
Quelques exemples :
- Former aux principes d'éco-conception les services impliqués dans le développement d'un service numérique.
- Lorsque le développement d'un logiciel est confié à un tiers, inclure le Référentiel général d’écoconception de services numériques (RGESN) comme clause dans le marché public.
La sensibilisation des élu·es et agents publics au numérique responsable et à la sécurité informatique
Pourquoi est-ce important ?
- Une fois sensibilisé·e, sur son lieu de travail, aux problématiques liées au numérique, il devient plus simple d'y prêter attention au quotidien. Et d'adopter de bonnes pratiques pour repenser ses usages - y compris dans sa vie privée.
- Connaître les risques en matière de cybersécurité et apprendre comment s'en prémunir est devenu indispensable, quel que soit le contexte.
Quelques exemples :
- Organiser des ateliers de formation au numérique responsable et en cybersécurité.
- Participer à des événements nationaux et internationaux comme le Digital cleanup day.
La sensibilisation des citoyen·nes aux enjeux environnementaux du numérique et de l’inclusion numérique
Pourquoi est-ce important ?
- Les services publics se dématérialisent de plus en plus. Se montrer exemplaire dans le domaine du numérique responsable, c'est ouvrir la voie pour que les bonnes pratiques en la matière deviennent évidentes pour tous·tes les citoyen·nes.
- Donner à chacun·e les moyens de se renseigner et d'agir, pour comprendre les enjeux du numérique et devenir un·e utilisateur·rice responsable des outils et services en ligne, participe en 2025 d'une mission de service public.
Quelques exemples :
- Organiser des conférences dans les écoles, médiathèques, centres sociaux...
- Favoriser la création de recycleries sur le territoire.
Un territoire connecté et durable, l'ouverture et la valorisation des données
Pourquoi est-ce important ?
- Définir quelles sont les données utiles à collecter sur le territoire, en toute transparence et dans le respect du RGPD (Règlement général sur la protection des données), permet d'obtenir des informations importantes au lieu de rassembler de la data au petit bonheur la chance.
- Rendre les informations d'intérêt général facilement accessibles à tous·tes permet de proposer une source de données publiques fiables, réutilisables par des chercheurs·ses, des enseignant·es, des associations... au service de projets servant la société civile.
Quelques exemples :
- Améliorer la qualité des services proposés en se basant sur les données collectées.
- Cartographier les acteurs locaux œuvrant pour un numérique plus responsable.
Références :
- Légifrance - LOI n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France
- Mission Interministérielle Numérique Responsable - Stratégie numérique responsable des collectivités : traduction opérationnelle du décret de l'article 35 de la loi REEN
- Arcep - Etude ADEME – Arcep sur l’empreinte environnementale du numérique en 2020, 2030 et 2050
[Photo de couverture : Getty Images]
Soutenez-nous en partageant l'article :