“Je n’ai jamais été capable de donner le bain à ma fille” : pour les cyberenquêteurs, la traque des pédocriminels se paie au prix fort
Outil central de la lutte contre la pédocriminalité, l’enquête sous pseudonyme confronte les agents à un double jeu éprouvant. Plusieurs d’entre eux ont confié aux “e-novateurs” le revers de ces infiltrations.
Par Clara Lainé
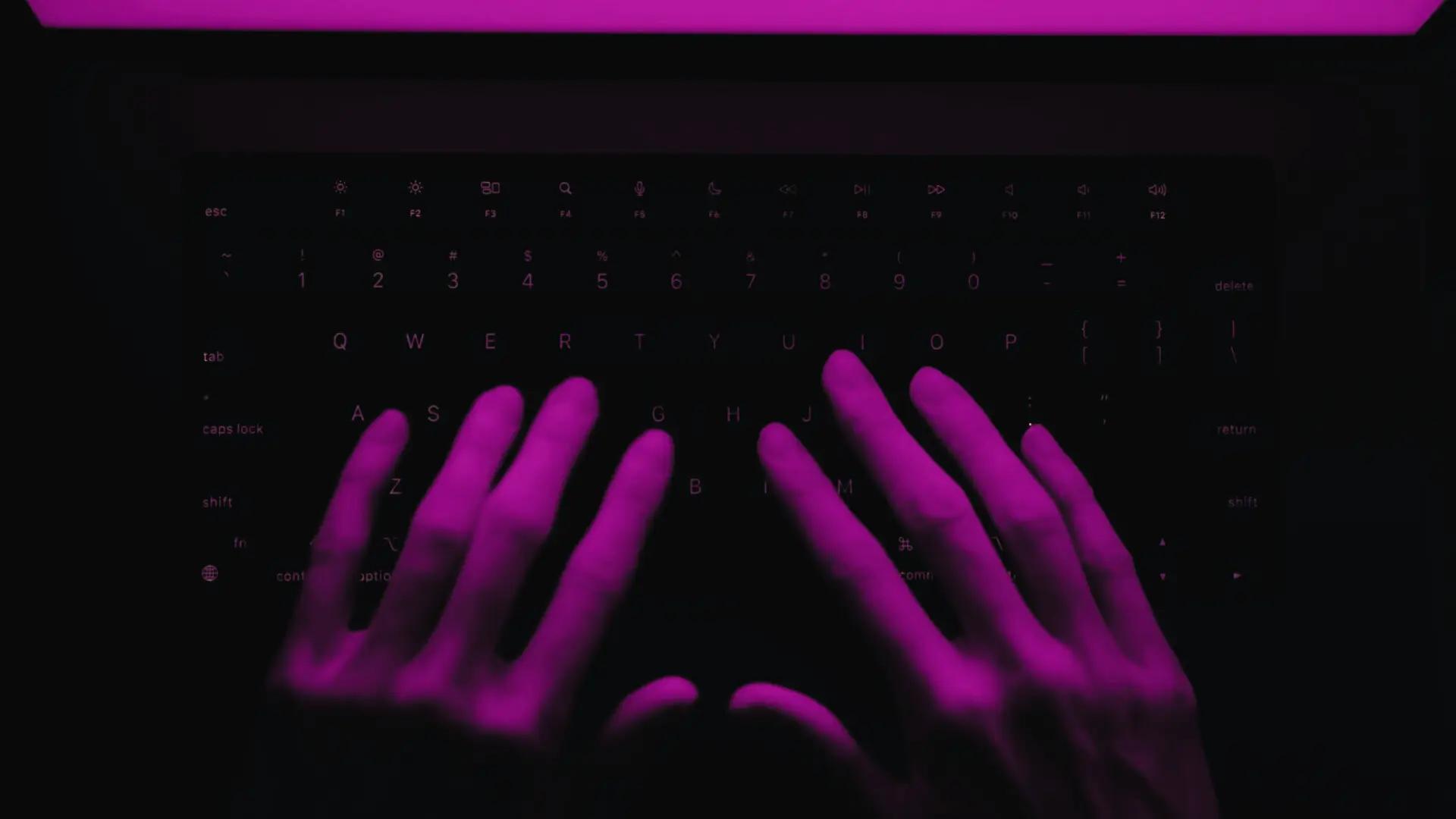
Le soir, quand la maison s’endort, Fabien* rallume son téléphone clandestin. Derrière le clavier, il se glisse dans la peau d’une collégienne et converse avec des prédateurs sexuels, persuadés de parler à une enfant. Doser les fautes d’orthographe, sélectionner les émojis, feindre la naïveté… tout est calculé. "Je change souvent de légende, mais la base est toujours la même : je choisis un profil féminin âgé de 13 ou 14 ans, car la corruption de mineurs est aggravée pour les mineurs de moins de 15 ans", précise le cyber-enquêteur, spécialisé en matière pédocriminelle.
870
signalements de contenus pédopornographiques par jour en moyenne en 2023
Source : OFMIN (Office mineurs)
Le travail de Fabien s’inscrit dans un contexte alarmant. Un rapport parlementaire de mai 2025 relève que l’Office mineurs a enregistré 318 000 signalements de contenus pédopornographiques en 2023, ce qui représente une augmentation de 12 000 % en dix ans. La France figure parmi les quatre pays hébergeant le plus de contenus de ce type.
Pour identifier les auteurs, l’infiltration en ligne s’est imposée comme un outil incontournable. Encadrée depuis la loi du 5 mars 2007, l’enquête sous pseudonyme autorise les policier·es et gendarmes formé·es à intervenir en ligne sous une fausse identité. Un arrêté d’avril 2025 a étendu le dispositif et permet désormais aux brigades territoriales d’y recourir, après habilitation. L'État mise de plus en plus sur ces "légendes numériques" pour contenir un phénomène devenu tentaculaire.
"C’est mon sacerdoce"
Si la plupart des enquêtes se bouclent en quelques jours, voire en quelques minutes, d’autres s’enlisent. "La plus longue que j’ai faite a duré six mois. Au bout d’un moment, je n'en pouvais plus. Plus ça dure, plus c’est dur !", lâche Fabien, qui travaille depuis plus de deux ans à l’office anti-cybercriminalité (OFAC). Pour tenir, il faut s’accorder de rares pauses, sous couvert d’un téléphone confisqué ou d’un devoir à terminer.
À la fin, c’était l’enfer. Je me disais en plein weekend familial : il faut que je lui écrive.
Fabien*, enquêteur de l'OFAC
Dans ces moments-là, la double vie devient lourde à porter. "Les collègues me demandent comment je gère. Honnêtement, moi-même, je ne sais pas", souffle-t-il. Pourtant, le quadragénaire encaisse. "Je n’ai pas le droit de faire autre chose parce que je suis capable de le faire et que peu le sont", considère celui qui a débuté sa carrière à la brigade des mineurs. Avant de lâcher : "c’est mon sacerdoce."
Pierre Lemaire, brigadier chef de police depuis un an et demi, partage ce sens du devoir :
Quand je recevais une photo à caractère pédopornographique, je me disais qu’au moins ce n’était pas une victime de 14 ans qui la voyait.
Pierre Lemaire, ex-enquêteur sous pseudonyme
Sur la plateforme Pharos (créée en 2009 pour combattre les infractions en ligne), il a mené, pendant plus de six ans, des enquêtes sous pseudonyme. Un "travail d’équilibriste", selon lui, soumis à de nombreuses contraintes.
"Quand on échange par message, il faut répéter plusieurs fois son âge pour que la personne en face ait bien conscience de la minorité", souligne-t-il. La ligne entre infiltration et provocation est mince, et la justice veille à ce que la distinction soit respectée. Le 15 janvier 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a ainsi rappelé qu’un·e policier·e ne peut pas "inciter à commettre une infraction qu’une personne n’aurait autrement pas commise". En France, la Cour de cassation a partagé cette analyse : la loyauté de la preuve prime.
Au-delà de ce jeu de funambule permanent, une autre pensée, plus intime, envahissait parfois le gendarme. "Ma crainte, c’était de tomber sur quelqu’un de mon entourage, qui gravitait autour de mes enfants", confie-t-il, un an et demi après avoir quitté l’enquête sous pseudonyme. Car derrière le protocole, il y a l’humain. Pour l’accompagner, des psychologues sont prévu·es au sein des services. À Pharos, les agent·es les rencontrent "au moins une fois par an", parfois plus quand ils·elles en expriment le besoin.
"Savoir être étanche"
Le seuil de tolérance varie d’un individu à l’autre : certains peuvent tenir deux ans à ces postes et d’autres, dix ans.
Carole Damiani, docteure en psychologie
Face à "l’océan" de violence qu’ils affrontent "avec une petite cuillère", il faut éviter de "s’amputer de ses émotions" car "quelqu’un qui se blinde tout le temps risque gros le jour où il part à la retraite et se retrouve seul", alerte Carole Damiani, également secrétaire générale de l’Association de langue française des études du stress et du trauma.
Dans ces métiers d’exposition permanente, "il faut savoir être étanche" pour ne pas se dissoudre dans la détresse du rôle qu'on endosse. Mais l’armure peut avoir ses failles. À force de jouer un personnage, le risque d’identification à la victime devient massif - jusqu’à la "fatigue compassionnelle", cette usure lente qui grignote le quotidien, plus insidieuse que le traumatisme vicariant : "Le danger, c’est de ne plus faire la différence entre le soi professionnel et le soi personnel" précise la docteure en psychologie.
Thomas*, investigateur en cybercriminalité, a toujours gardé une distance prudente avec les psys de son service. La première fois que cet officier de police judiciaire a franchi la porte de leur cabinet, c’était presque à contrecœur. "J’avais peur qu’on pense que je ne faisais pas le poids, qu’on me mette au placard." Alors, quand on lui a demandé comment il allait, la réponse a fusé : "bien". Il a toutefois testé l’hypnose ou l’EMDR, "à l’extérieur du boulot" auprès de spécialistes auxquels il n’a pas mentionné son vrai nom, ni être policier.
Recruté après les attentats de Charlie Hebdo, Thomas intègre l’OCLCTIC (Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, devenu l’OFAC en 2023) - une unité hybride à l’époque, où les débuts de l’enquête sous pseudonyme se déroulent "sans véritable cadre". Après dix ans passés sur le terrain, le policier y découvre la cybercriminalité et sa part la plus sombre : la pédopornographie.
C’est la matière la plus difficile que j’ai eue à traiter. Et pourtant, j’ai fait énormément de contre-terrorisme.
Thomas*, investigateur en cybercriminalité
Pour ne pas la laisser envahir la maison, "je me suis toujours refusé à discuter des détails avec ma femme, pour la préserver." À défaut, il se confiait à ses collègues : "on se raconte énormément de choses entre nous, on bosse en open space, on développe un humour noir très glaçant." Aujourd’hui, il ne travaille plus cette matière, mais certaines traces demeurent. Père d’une fille de huit ans, Thomas confie : "Je n’ai jamais été capable de lui faire prendre un bain, de la voir nue. Et ça, c’est quelque chose que je ne récupérerai jamais."
"Le crime n’a pas d’heure"
Diane Salomon, docteure en psychologie spécialisée dans la prise en charge du traumatisme sexuel, souligne que "l'événement qui fait trauma est un événement sur lequel on n’a aucun pouvoir, une situation d’impuissance totale". Or, dans l’enquête sous pseudonyme, l’agent·e n’est pas passif·ve : il·elle dialogue, interprète, relance, joue un rôle.
Le fait d’avoir un objectif permet de se rendre acteur, et donc de prévenir en partie le risque de sidération et de culpabilité.
Diane Salomon
Mais l’équation reste délicate. "Le crime n’a pas d’heure", soupire-t-elle. Limiter l’exposition aux contenus violents à des horaires de bureaux relève de l’impossible quand il faut incarner une collégienne de treize ans, en ligne après les cours parfois tard le soir. "On peut mettre en place des stratégies, mais il n’y a pas de règle absolue", pointe la psychologue clinicienne passée par plusieurs services de police. Elle plaide donc pour la souplesse.
"Chacun doit établir son cadre, son rituel. Pour certains, c’est une pièce à part, pour d’autres une activité avant ou après. Jouer au Tetris après avoir été exposé à un contenu violent, par exemple, peut aider à couper psychiquement." L’essentiel, insiste-t-elle, "c’est de marquer la frontière entre le professionnel et l’intime."
Diane Salomon tient par ailleurs à rappeler que les cyber-enquêteurs·rices ne sont pas les seul·es à marcher sur cette ligne de crête. "On oublie les avocats, les magistrats, les interprètes, les modérateurs de plateformes…" Tous ces métiers, à leur manière, absorbent une part de la violence du monde. Avant de refermer leur ordinateur, d’enlever le masque professionnel et de lancer, la voix un peu lasse : "Sacrée journée… On mange quoi ce soir ?" Parfois, la réponse s’impose d’elle-même. L’estomac est trop noué pour avaler quoi que ce soit.
*Le prénom a été modifié.
Références :
- Assemblée nationale - Rapport n° 1372, déposé le mercredi 7 mai 2025
- Légifrance - Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, chapitre V, article 35
- Légifrance - Article 230-46, Code de procédure pénale, chapitre 7
- Légifrance - Arrêté du 17 avril 2025 modifiant l'arrêté du 21 octobre 2015 relatif à l'habilitation au sein de services spécialisés d'officiers ou agents de police judiciaire pouvant procéder aux enquêtes sous pseudonyme
- Légifrance - Arrêté du 16 juin 2009 portant création d'un système dénommé « PHAROS » (plate-forme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements)
- Cour européenne des droits de l’homme - Requêtes n° 40495/15
- Légifrance - Pourvoi 05-84.837, Cour de cassation, 2006
- Centre national de ressources et de résilience - Traumatisme vicariant
- Centre national de ressources et de résilience - Des termes souvent confondus
- France Culture - Le trauma vicariant
- Légifrance - Décret n° 2023-1083 du 23 novembre 2023 portant création de l'office anti-cybercriminalité
[Photo de couverture : Wesley Tingey]