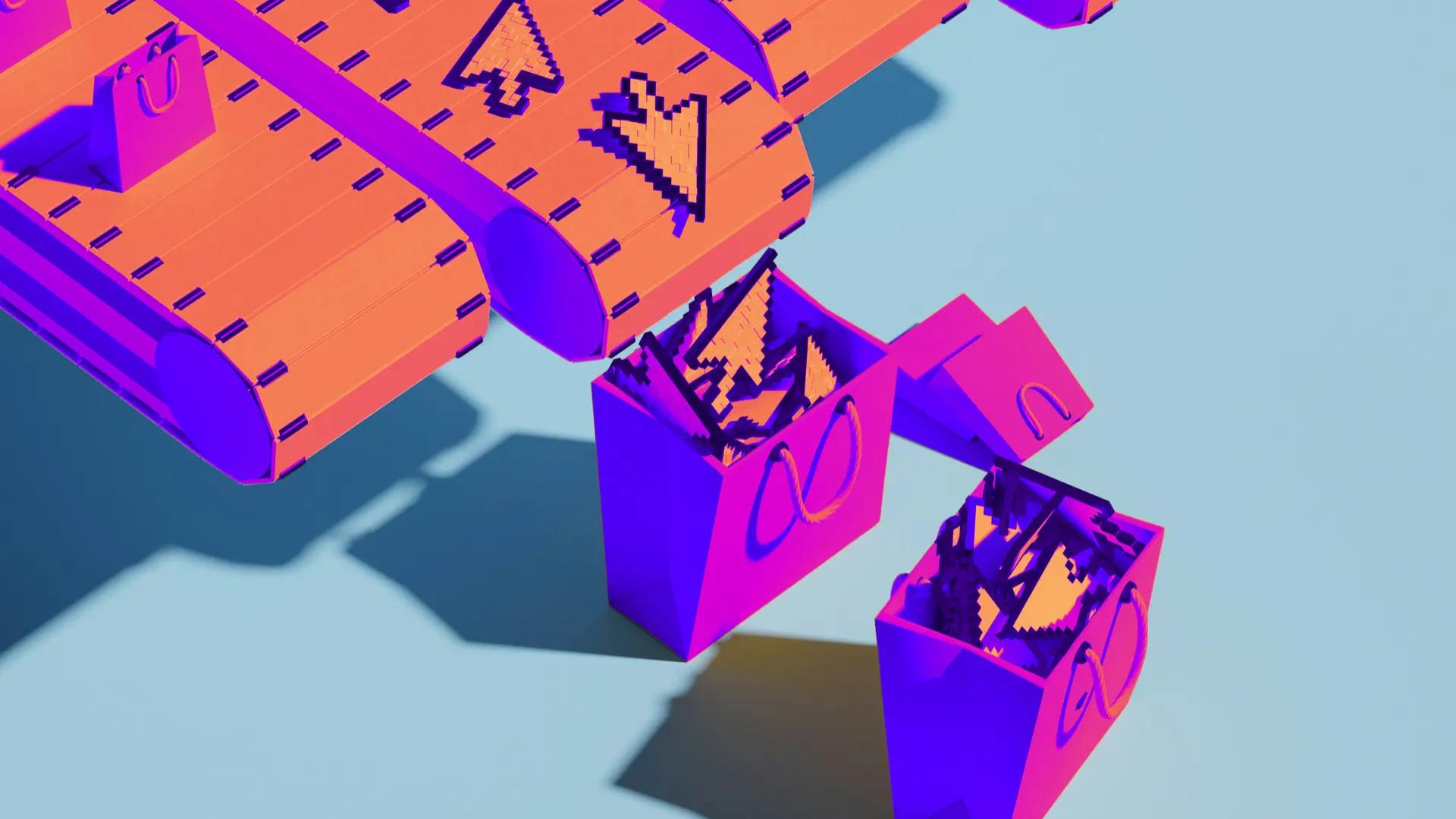La protection des mineurs en ligne, au prix de l'anonymat des internautes ?
Les affaires Pornhub et Jean Pormanove ont relancés les débats sur la vérification de l'âge en ligne. Au nom de la protection des mineur·es, l'anonymat sur Internet semble fragilisé, laissant craindre une généralisation des contrôles d'identité en ligne et un renforcement de la surveillance.
L'article que vous allez lire a nécessité 2 journées de travail.
Site bloqué, accessible, puis de nouveau bloqué. En refusant de se plier à la loi SREN, Pornhub illustre les tensions croissantes autour de la fin de l’anonymat en ligne. Si cette législation vise à Sécuriser et Réguler l’Espace Numérique, notamment en exigeant des sites pornographiques des outils de vérification d’âge pour restreindre leur accès aux mineur·es, sa mise en pratique ne fait pas l'unanimité.
Les vérifications d'identité en ligne devraient également concerner les paris sportifs et les réseaux sociaux - un débat récemment relancé par le décès en live du streamer Jean Pormanove. Et elles ne se limitent pas à la France : au niveau européen, des mesures similaires sont impulsées par le Digital Services Act, qui régule les grandes plateformes numériques et renforce la protection des consommateurs·rices.
L’objectif de protéger les mineur·es est légitime, mais soulève des questions : peut-on sécuriser sans surveiller ? Protéger sans tracer ? Si Pornhub reconnaît que les citoyen·nes français·es « méritent une réglementation qui empêchera les enfants d'accéder à des contenus pour adultes », le site insiste également sur leur droit à la protection de « leur vie privée et de leurs données personnelles ».

Cet article est gratuit
Aidez-nous pour que ça le reste !
« Il y a toujours un risque que les données soient compromises »
Ingénieur en réseaux informatiques et auteur de Cyberstructure : L’Internet, un espace politique, Stéphane Bortzmeyer estime que le numérique est souvent révélateur de fractures plus anciennes, mais que « du fait que l’activité soit en ligne, des lois sont adoptées alors que si elles étaient appliquées dans le monde réel, elles seraient associées à un État autoritaire ».
Quoi qu'il en soit, le train est en marche. De nombreuses solutions techniques sont avancées pour vérifier l’âge en ligne : empreinte de carte bleue, reconnaissance faciale, identité numérique, signature cryptographique, certification par un organisme tiers...
Toutes impliquent de multiplier les données personnelles fournies, ce qui peut être perçu comme contraire au principe de minimisation induit par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Selon la législation européenne, les données personnelles collectées doivent être adéquates, pertinentes et limitées. Une manière d'assurer la protection de la vie privée, mais aussi de prévenir les risques liés aux cybermenaces.
« Il y a toujours un risque que les données soient compromises dès qu’une information est en ligne », reconnaît Antoine Gaume, ingénieur et expert IT & Privacy à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). La fuite de données subie par Free en octobre 2024, où des copies de pièces d’identité ont été revendues sur les marchés noirs, en est une illustration.
Le risque 0 n’existe pas. Plus il y a de données fournies, plus il y a de risques.
Stéphane Bortzmeyer
Des tiers vérificateurs entre les internautes et les sites
Face à ces inquiétudes, la CNIL recommande le double anonymat, qui consiste en une certification de l'âge par un organisme extérieur. Un tiers de confiance se positionnerait ainsi en intermédiaire entre le site et un·e visiteur·se. Cette structure tierce aurait connaissance de l'identité de l'internaute et fournirait à la plateforme uniquement une preuve de majorité sous forme de clé cryptographique. Aucune donnée personnelle ne serait donc fournie au site visité.
« Le double anonymat fonctionne très bien en labo, mais en pratique de nombreux défis techniques perdurent. Il n’a d’ailleurs pas encore été déployé », pointe Stéphane Bortzmeyer. Dans l'attente, les sites devraient se retrouver à développer leur propre solution pour vérifier l'âge des internautes.
Pornhub est une entreprise opaque, nous ne savons pas ce qu’ils font de leurs données. Pourquoi leur en fournir davantage ?
Stéphane Bortzmeyer
S’il y a encore des obstacles à dépasser pour rendre opérationnel le double anonymat, plusieurs acteurs privés fournissent déjà des services de vérification d’identité et pourraient le proposer, dont Ariadnext et Yoti. Docaposte propose une alternative publique. D'autres solutions publiques pourraient également être envisagées, notamment via l’identité numérique.
Entre confiance et défiance
« L’idéal serait d'offrir aux internautes le choix entre des acteurs publics et privés afin qu’ils puissent s’orienter vers la solution qui leur apporte le plus de confiance », souligne Vincent Toubiana, chef du Laboratoire d’innovation numérique de la CNIL.
Derrière cette position se cachent des enjeux politiques : « Les membres de la communauté LGBT hongroise pourraient préférer, par exemple, un tiers vérificateur privé ». Pour cause, la communauté LGBTQI+ hongroise se trouve dans le viseur de l'Etat et voit ses droits se restreindre. La vérification de l'identité sur les sites pornographiques pourrait alors faire peser des craintes quant à une surveillance des contenus gays ou lesbiens.
La multiplication des acteurs - privés et publics - soulève néanmoins des questions quant à la standardisation des processus et de leur contrôle, particulièrement en l’absence de normes internationales. Toutefois, comme les tiers vérificateurs commercialisent de la confiance, la coopération avec la CNIL et ses homologues européens devrait être facilitée... sur le papier.
« Il serait plus aisé d’auditer ces organismes. Dans la théorie, ils seraient également moins exposés aux risques car la gestion de données sensibles constitue leur cœur de métier », estime Antoine Gaume.
Le risque de l’habituation
Un autre frein au déploiement du double anonymat tient dans une potentielle réticence du public à l’utiliser. Si les tiers vérificateurs concernent uniquement des usages peu admis par les mœurs, comme la pornographie ou les sites de paris, leur emploi pourrait constituer un marqueur stigmatisant. « Le simple recours à ces outils pourrait suffire à révéler des comportements socialement mal perçus », pointe Stéphane Bortzmeyer.
Au-delà de cette question d’image, un autre sujet préoccupe : l’habituation. Une multiplication progressive des usages de vérification d’identité pourrait banaliser ces pratiques. Une normalisation que la CNIL souhaite éviter.
Nous ne voulons pas que les gens s’habituent à donner leur visage ou leur carte d'identité sur Internet.
Antoine Gaume
L’élargissement du cadre juridique initial a d’ailleurs déjà été observé, notamment avec le Fichier national automatisé des empreintes génétiques. Initialement prévu pour les auteurs·rices d’infractions sexuelles, son usage s’est démocratisé à la plupart des crimes et délits d'atteinte aux personnes et aux biens, à l'exception des infractions financières.
Stéphane Bortzmeyer met également en évidence une dérive possible sur la surveillance de l’activité en ligne par l’attribution de clés traçables. « C’est un sujet que nous avons soulevé au ministère de l’Intérieur », confirme Antoine Gaume qui estime que « ce n’est pas dans l’intérêt du ministère » car cela entraverait l'adoption des services de vérification d'âge.
Le rôle de l’éducation face à la tentation du tout-technique
Au-delà des solutions techniques, une autre dimension mérite d’être prise en compte : l’éducation. Pour Michaël Stora, fondateur de l’Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines, la réponse doit aussi être éducative. S’il est favorable à un cadre empêchant l’accès des moins de 13 ans aux sites pornographiques, il insiste sur le rôle clé de l’accompagnement.
Constatant que « beaucoup de parents sont débordés et n’arrivent pas à fixer de cadre », il plaide pour un renforcement de l’éducation à la sexualité et au numérique. « Il faut moderniser ces programmes, offrir un cadre pour aborder librement les sujets sensibles et créer des groupes de parole. »
Quant à la question de l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans, il souligne la part de responsabilité des plateformes. « Le vrai problème est la modération, mais le gouvernement a du mal à l’imposer. » L'affaire Jean Pormanove, dénoncée par Médiapart dès décembre 2024, l'illustre.
Michaël Stora se remémore une autre époque : « J’ai été modérateur sur Skyblog. On repérait les contenus suicidaires pour orienter les jeunes vers des structures de soin ». Un travail humain qui, selon lui, fait cruellement défaut aujourd’hui.
Références :
- Aylo - Aylo Suspend Accès à Pornhub en France
- Cyberstructure - Internet, un espace politique
- Que Choisir - Fuite de données chez Free, des données un peu trop libres !
- CNIL - Vérification de l'âge en ligne : la CNIL a rendu son avis sur le référentiel de l’Arcom concernant l’accès aux sites pornographiques
- Amnesty International - Hongrie. La Loi relative à la propagande a « créé un climat de peur » qui relègue la communauté LGBTI+ dans l’ombre
- Syndicat de la Magistrature - FNAEG : Ne vous en fichez pas !
- Syndicat de la Magistrature - La CEDH impose son empreinte contre le fichage génétique massif
[Photo de couverture : Jon Tyson]
Soutenez-nous en partageant l'article :